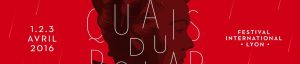Toujours + ! (un bilan de 2021)
N’étant pas très top, chiffres et classements, mais soucieux tout de même de jeter un dernier coup d’œil en arrière avant d’enchaîner avec 2022, je vous propose aujourd’hui un petit bilan de mes lectures préférées de 2021. Comme l’année dernière, mais en une seule fois, avec moins d’entrées, et seulement les coups de cœur. Une décision dictée essentiellement par le fait que ces derniers ont été plus rares cette année, plus sélectifs, alors même que j’ai lu une centaine de livres, à peu près comme d’habitude.
En faisant le point, j’ai vu quelques titres se détacher avec évidence. Les voici réunis ici, avec un lien vers la chronique qui leur a été consacrée (à une ou deux exceptions près dépourvues d’article… qui viendra bientôt ?)
Le + bouleversant : Sidérations, de Richard Powers (Actes Sud)
Mon coup de cœur majeur de 2021. Un roman profondément touchant, poignant, et en même temps d’une intelligence éblouissante, croisant avec évidence des sujets aussi divers que la neurobiologie, l’astrophysique, l’écologie, la famille, l’enfance, le deuil, la politique…
Je vous invite à voyager jusqu’au blog de l’ami Yvan Fauth, Émotions, qui a eu la gentillesse de me convier dans son top 10 en forme de regards croisés afin d’y poser quelques mots sur ce roman. Je n’ai sans doute rien écrit de mieux à son sujet que pour cette occasion, vous savez donc ce qu’il vous reste à faire !
Le + puissant : Lorsque le dernier arbre, de Michael Christie (Albin Michel)
Imparable. C’est l’adjectif qui me revient obstinément en tête lorsque je pense au deuxième roman du Canadien Michael Christie (le premier reste inédit pour le moment en France). Impossible en effet de résister à la puissance narrative et à la construction en spirale de Lorsque le dernier arbre, qui nous attrape en 2038, dans un futur proche et anxiogène terriblement réaliste, pour nous conduire au cœur du livre jusqu’en 1908, au fil de bonds générationnels passant par 2008, 1974 et 1934 ; avant de repartir dans le sens inverse par les mêmes étapes pour nous ramener, à bout de souffle et étourdis d’admiration, à la case départ.
Un immense roman de personnages, dont le cœur convoque l’ombre inspirante de John Steinbeck en personne. Une très grande découverte pour moi.
Le + polar : La République des faibles, de Gwenaël Bulteau (La Manufacture de Livres)
J’ai suivi l’année polar de loin, certes, pendant un peu plus de la moitié de l’année, avant de reprendre mon métier de libraire en septembre. Néanmoins, j’ai eu le sentiment (à tort ou à raison, à vous de me le dire en commentaire) que le genre marquait le pas. S’il assure toujours autant de ventes, c’est plus que jamais par le biais d’usines à best-sellers (Bussi, Coben, Connelly, Minier, Thilliez, Grangé…) dont l’intérêt littéraire global reste à débattre. En terme d’originalité et de renouvellement, en revanche, ça coince un peu – ou du moins, j’ai de plus en plus de mal à y trouver mon compte.
Tout ça pour dire que le premier roman de Gwenaël Bulteau fait office d’heureux contre-exemple. S’il ne renouvelle pas l’exercice du polar historique (difficile à faire, cela dit), il lui ajoute une excellente référence, sombre, nerveuse, très bien menée et sertie de personnages remarquablement campés et nuancés. Le tout à une époque passionnante (la fin du XIXème siècle, en plein tourment de l’affaire Dreyfus) et à Lyon, histoire de changer un peu de cadre. Une réussite, dont j’attends la suite avec impatience.
Le + doux : Esther Andersen, de Timothée de Fombelle & Irène Bonacina (Gallimard-Jeunesse)
Il fallait bien que je case mon chouchou quelque part dans cette liste : voilà chose faite. Et avec ce merveilleux album, pas (encore) chroniqué sur le blog, plutôt qu’avec le tome 2 d’Alma paru également en 2021, qui m’a très légèrement moins emporté que d’habitude.
Esther Andersen, donc, avec son nom de chanson de Vincent Delerm – ou d’album de Sempé.
Sempé auquel on est obligé de penser en découvrant les illustrations vivantes, bien vues et délicates d’Irène Bonacina, à l’évidence inspirée par le maître. On pourrait crier à la facilité, mais il se trouve que ce trait colle parfaitement à l’histoire ciselée ici par Timothée de Fombelle. Un récit d’enfance, d’été, de plage lointaine, d’oncle bienveillant, de balades à vélo, et de premier amour en forme de coup de foudre fugace.
Un délice absolu, tendre et poétique.
Le + joueur : Les embrouillaminis, de Pierre Raufast (Aux Forges de Vulcain)
Écrivain joueur par excellence, Pierre Raufast réinvente le roman dont vous êtes le héros, genre culte chez les jeunes lecteurs des années 80-90, dont il propose une version littéraire à la fois ludique et riche en belles réflexions, sur les choix de nos vies, sur l’amour, l’amitié, les héritages familiaux, mais aussi sur l’écriture elle-même. Un livre à lire et relire, pour en découvrir les nombreuses nuances et les surprises cachées. Jouissif !
Le + nostalgique : Goldorak, de Dorison, Bajram, Cossu, Sentenac et Guillo (Kana)
Ça aurait pu n’être qu’une récupération opportuniste, mais non. Il faut dire que le quintette à l’œuvre derrière cette somptueuse bande dessinée, à commencer par son inspirateur principal Xavier Dorison, sont des enfants des années 80. De solides quarantenaires, biberonnés aux dessins animés cultes de cette époque, au premier rang desquels l’incontournable Goldorak.
Avec la bénédiction de Go Nagai, créateur japonais du robot géant, les cinq auteurs proposent une suite et fin hyper crédible à l’anime original, mêlant action, suspense, humour, une réflexion poignante sur l’héroïsme et ses conséquences, le tout servi par un dessin moderne qui rend hommage à l’œuvre de Go Nagai tout en s’en affranchissant avec une liberté rafraîchissante.
Le + prometteur : La Tour de Garde 1 – Capitale du Sud t.1 : le Sang de la Cité, de Guillaume Chamanadjian (Aux Forges de Vulcain)
Pierre d’angle d’une double trilogie menée conjointement par Guillaume Chamanadjian et Claire Duvivier, ce premier volet commence en douceur pour mieux envoyer du bois au fur et à mesure que le primo-romancier met en place le fabuleux décor de son histoire (la ville de Gemina, fameuse capitale du sud du titre) et les ramifications complexes des intrigues qui l’animent.
De la fantasy politique de haute volée, pleine d’idées et d’ambition, qui promet de nombreuses belles pages d’évasion dans les cinq tomes à venir. (Je n’ai pas encore lu le premier volume de Capitale du Nord, signé Claire Duvivier, mais cela ne saurait tarder !)
Le + « roman léger mais bien écrit quand même vous voyez » : Badroulboudour, de Jean-Baptiste de Froment (Aux Forges de Vulcain)
Cette question, les libraires ont appris à vivre avec depuis un paquet d’années à présent – à moins qu’elle ait toujours été posée, mais je ne me souviens pas de l’avoir si souvent entendue au début de ma carrière… Bref, de quelle question parle-t-on ? Celle que posent nombre de clients, notamment à l’approche de Noël, désireux de trouver une perle rare : un roman distrayant, voire drôle, en tout cas « léger » (le mot est lâché, faites-en ce que vous voulez), mais tout de même bien écrit, et intelligent si possible. Une sorte de graal, en somme.
Pour ma part, j’ai fini par en faire une sorte de jeu : dénicher régulièrement ce fameux livre idéal, qui peut prendre plusieurs formes, avouons-le tout de suite, et ne pas plaire à tout le monde – ce serait trop simple.
Au fil des années, dans cette catégorie, on a pu trouver par exemple Le Liseur du 6h27 de Jean-Paul Didierlaurent, ou pourquoi pas En attendant Bojangles d’Olivier Bourdeaut, voire La Vérité sur l’affaire Harry Québert de Joël Dicker (même si, pour la qualité du style, au sujet de celui-là, on repassera).
Et donc, mon chouchou de cette année, ma pépite personnelle, c’est Badroulboudour, le deuxième roman de Jean-Baptiste de Froment. Soit un livre qui, en 200 pages, réussit l’exploit de mêler un ton délicieusement piquant, de l’humour, du mystère, une rêverie érudite autour des Mille et une nuits… et de conclure le tout par un joyeux grain de folie et une histoire d’amour inattendue. Un vrai petit bonheur, en effet « léger » (quoi que cela veuille dire) et intelligent, que je vous recommande à nouveau chaleureusement.
Quelques mentions en + :


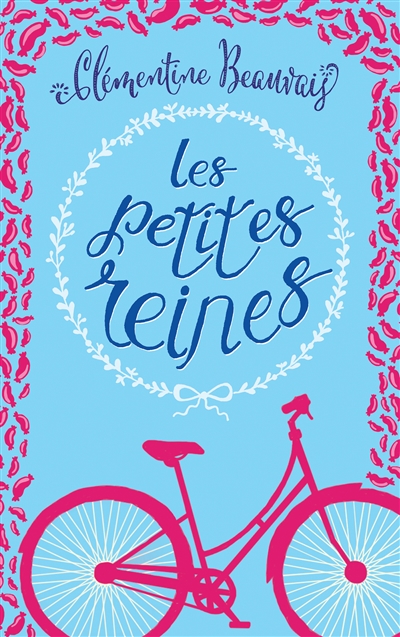
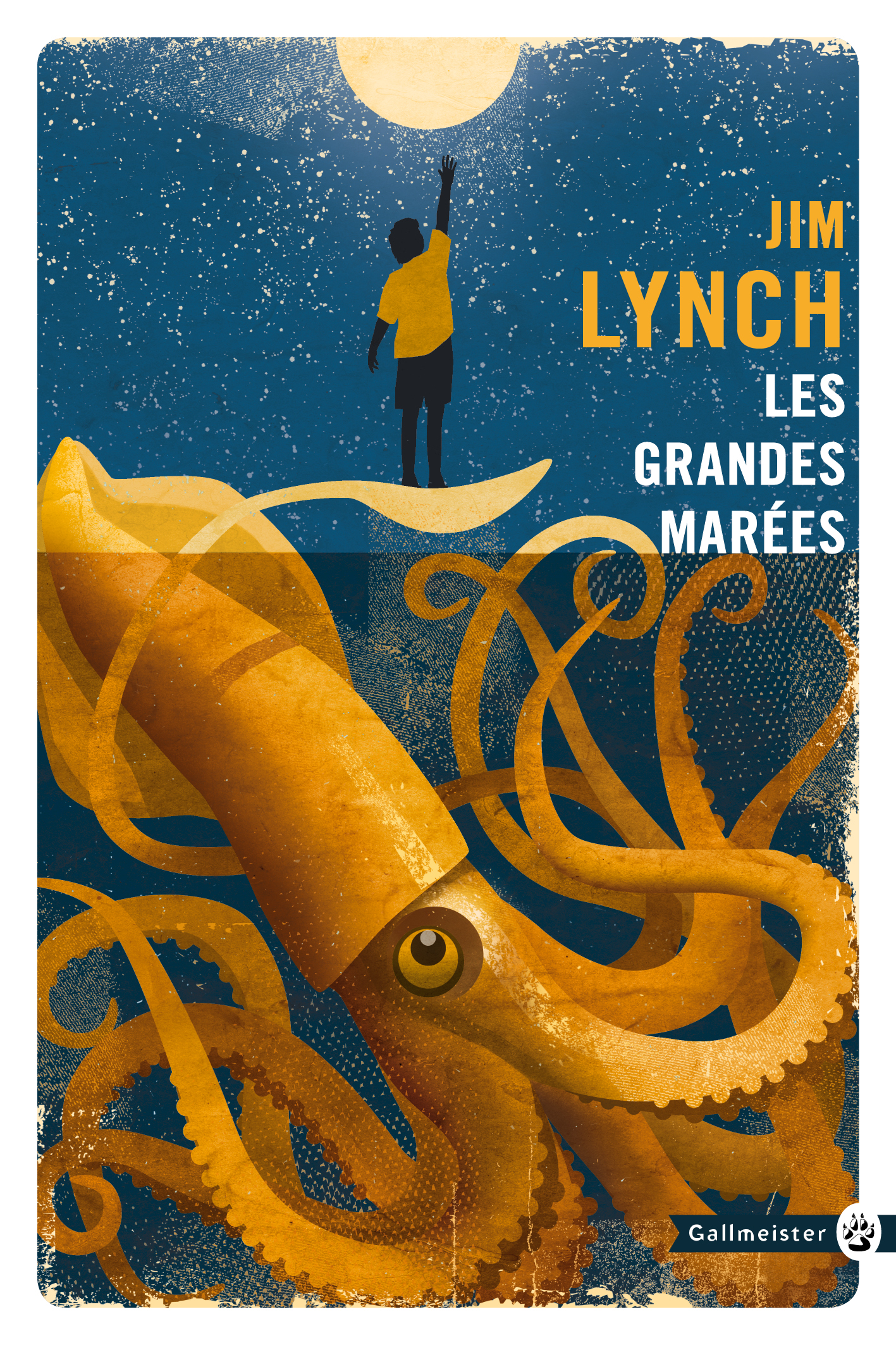
Nos corps étrangers, de Carine Joaquim (La Manufacture de Livres)
Un « presque » premier roman décapant, affirmation d’une voix aussi brute que torturée, qui mène un récit terrible sans jamais relâcher la pression, jusqu’à un final terrifiant. Auteure à suivre de très près.
Songe à la douceur et Les petites reines, de Clémentine Beauvais (Sarbacane)
Il fallait bien qu’un jour je mette le nez dans les livres de la prodigieuse Clémentine Beauvais. Bien m’en a pris de céder enfin, car ces deux lectures, pourtant très différentes, m’ont subjugué. Je vous laisse relire les chroniques correspondantes pour comprendre pourquoi.
Les grandes marées, de Jim Lynch (Gallmeister, coll. Totem)
En parlant de prendre son temps avant de lire un livre qu’on me recommandait depuis longtemps, en voici un autre bel exemple. Autant avouer que j’ai adoré me plonger (ah ah) enfin dans ce roman d’apprentissage aussi riche que chaleureux.
Pour en savoir plus, guettez le prochain rapport d’enquête du blog !
À première vue : la rentrée Liana Levi 2021
Intérêt global :
Liana Levi fait partie de ces éditrices qui développent une belle relation de confiance et de fidélité avec ses auteurs. Ceux-ci la suivent et l’accompagnent durant de longues années, à l’image de Iain Levison ou Milena Agus, par exemple, et enrichissent son catalogue d’œuvres consistantes, solides et souvent éclairantes sur le monde.
Déjà tous publiés au moins une fois par Dame Liana, les deux Françaises et l’Américain qui constituent son programme de rentrée 2021 sont à l’image de cette collaboration fructueuse et d’une grande diversité.
Les étoiles les plus filantes, d’Estelle-Sarah Bulle
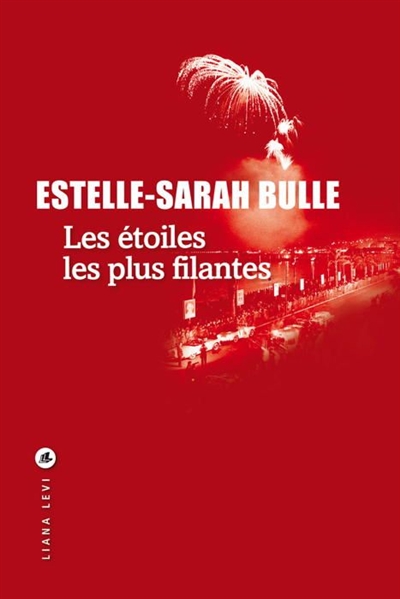
Son premier roman, Là où les chiens aboient par la queue, avait rencontré un franc succès en 2018. Estelle-Sarah Bulle était donc attendue, et elle a choisi de prendre une direction très différente de ses débuts largement autobiographiques en s’inspirant d’Orfeu Negro, film de Marcel Camus qui transposait le drame d’Eurydice et Orphée dans les favelas brésiliennes.
Elle imagine donc le débarquement de l’équipe de tournage dirigée par Aurèle Marquant dans une favela de Rio de Janeiro, qui entame une aventure autant humaine qu’artistique, sur fond de bossa nova, de passions débridées et d’intérêts contradictoires – car l’argent et la politique ne sont jamais très loin…
Le Mississippi dans la peau, d’Eddy L. Harris
(traduit de l’anglais (États-Unis) par Pascale-Marie Deschamps)
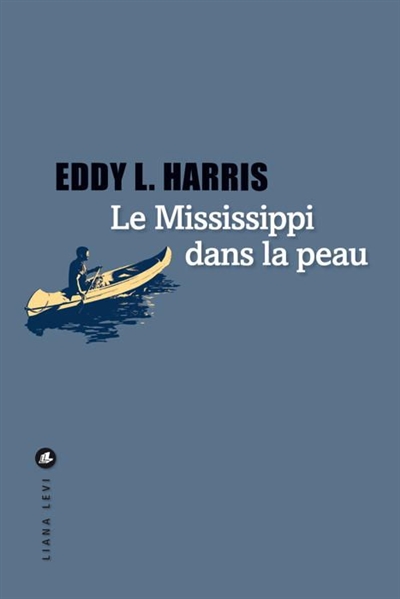
En présentant l’année dernière Mississippi Solo, récit d’une descente solitaire du grand fleuve en canoë, je faisais le parallèle entre le projet de ce livre et certaines œuvres du gallmeisterien Pete Fromm.
Je ne croyais pas si bien comparer puisque, à l’instar de son collègue du Montana rééditant la même expérience à vingt ans d’intervalle (surveiller la croissance d’œufs de poisson) et les relatant dans deux livres miroirs (Indian Creek et Le Nom des étoiles), Eddy L. Harris décide de refaire trente ans après le voyage qui a changé sa vie.
C’est l’occasion, bien sûr, d’une réflexion sur lui-même, sur le temps qui passe, mais aussi sur le fleuve et la nature, et sur les États-Unis, ses mutations et ses tensions raciales plus fortes que jamais.
Et ils dansaient le dimanche, de Paola Pigani

Remarquée dès son premier roman, N’entre pas dans mon âme avec tes chaussures (2013), l’auteure lyonnaise publie son quatrième en cette rentrée. Et nous ramène presque un siècle en arrière, aux côtés de Szonja, une émigrée hongroise qui arrive à Lyon et se trouve embauchée dans une usine de production de viscose. Postée plus de dix heures par jour à l’atelier, elle résiste grâce à Elsa, qui l’introduit dans un groupe d’Italiens actifs. La petite troupe fait la fête le dimanche, parle politique et participe aux manifestations, tandis que le Front populaire se renforce.
BILAN
Lecture probable :
Les étoiles les plus filantes, d’Estelle-Sarah Bulle
Lecture potentielle :
Le Mississippi dans la peau, d’Eddy L. Harris
COUP DE CŒUR : La République des faibles, de Gwenaël Bulteau
Éditions la Manufacture de Livres, 2021
ISBN 9782358877190
368 p.
19,90 €
Le 1er janvier 1898, un chiffonnier découvre le corps d’un enfant sur les pentes de la Croix Rousse. Très vite, on identifie un gamin des quartiers populaires que ses parents recherchaient depuis plusieurs semaines en vain.
Le commissaire Jules Soubielle est chargé de l’enquête dans ce Lyon soumis à de fortes tensions à la veille des élections. S’élèvent les voix d’un nationalisme déchainé, d’un antisémitisme exacerbé par l’affaire Dreyfus et d’un socialisme naissant.
Dans le bruissement confus de cette fin de siècle, il faudra à la police pénétrer dans l’intimité de ces ouvriers et petits commerçants, entendre la voix de leurs femmes et de leurs enfants pour révéler les failles de cette république qui clame pourtant qu’elle est là pour défendre les faibles.
Attention, pépite. Doublée d’une découverte, puisqu’il s’agit du premier roman de Gwenaël Bulteau.
Encore une superbe trouvaille à mettre à l’actif des éditions de la Manufacture de Livres, qui a déjà publié en janvier le remuant Nos corps étrangers de Carine Joaquim.
Changement de décor entre les deux livres, en revanche, puisque La République des faibles est un polar historique. Ancré à Lyon, dont la géographie et la sociologie de l’époque sont rendues avec précision et acuité, totalement au service de l’intrigue très élaborée qu’imagine par le romancier.
Néo-lyonnais depuis bientôt six ans, cela faisait un moment que je cherchais des romans qui prennent cette ville comme cadre de maière totalement convaincante. Hormis La Part de l’aube d’Éric Marchal, et dans une moindre mesure Le Fleuve guillotine d’Antoine de Meaux, j’ai souvent fait chou blanc.
La République des faibles est, de très loin, le meilleur que j’aie pu lire.
Gwenaël Bulteau frappe très fort, en effet, à tous points de vue. Pour commencer, par son choix de l’époque et l’intelligence avec laquelle il l’utilise.
1898 : à peine vingt ans après la défaite de 1870, guerre dont les traumatismes sont encore patents ; en pleine affaire Dreyfus, qui attise la violence des opinions et exacerbe les passions dans toutes les strates de la société ; et à l’orée d’un siècle nouveau que l’on espère neuf, mais dont tout le contexte laisse craindre qu’il sera tourmenté.
Ces tensions, l’écrivain les donne à voir, en promenant sa plume attentive dans les rues, en surprenant des conversations, en captant à l’improviste altercations, injures, bagarres. Son suspense, il l’installe dans une ville nerveuse, sombre, déchirée, à l’image de la France de l’époque. Le décor est saisissant, et pourtant, jamais déployé avec ostentation. Le tableau est toujours juste, et a le bon goût de ne pas prendre toute la place.
Car de la place, il en faut, pour les personnages et pour la langue du roman.
Les personnages, pour commencer. Flics, voyous, témoins, simples passants, bourgeois, tous jouent des partitions subtiles et complexes, dont les variations ne cessent de surprendre, suivant les tours et détours d’une intrigue remarquablement dense et tourmentée, de bout en bout. Les zones d’ombre sont légion, les bonnes volontés se heurtent à la nécessité de faire parler la force, la menace et la brutalité pour obtenir des résultats.
Surtout, le romancier nous installe de plain-pied dans cette fameuse « République des faibles ». Celle des laissés-pour-compte, des délaissés de la société, des âmes perdues dans la gadoue, la crasse et l’oubli. Dans cette triste armée, les enfants sont en première ligne, qui forment le cœur du bataillon dont Gwenaël Bulteau met en lumière les souffrances.
– Avez-vous déjà entendu parler de la république des faibles ? demanda le commissaire au bout d’un moment.
– Comme tout le monde, répondit-elle en se retournant. C’est une belle idée de mettre le droit au service des individus sans défense. Malheureusement, et croyez-en ma longue expérience de femme, cette conception n’a jamais été d’actualité.
Et puis il y a la langue. Le style. Pas d’approximation chez Gwenaël Bulteau, on sent dès ce premier roman qu’il possède une véritable voix, et qu’il en use avec une belle maîtrise.
Impossible de ne pas penser à Hervé Le Corre, l’un des plus grands maîtres français du genre, surtout quand il s’agit d’explorer l’Histoire (je vous renvoie par exemple à Dans l’ombre du brasier, plongée vertigineuse dans la Commune de Paris, à laquelle on assiste au plus près du bitume, telle que je ne l’avais vue ou lue).
Gwenaël Bulteau n’a pas à rougir de cette comparaison flatteuse, qu’il mérite amplement. Il tient son rythme sans jamais flancher, joue des registres de langue en évitant les clichés ; et si son roman laisse autant de traces en mémoire (je l’ai lu en décembre et il me hante toujours), la puissance des images suggérées par son écriture y est pour beaucoup.
Je pourrais continuer encore longtemps, mais ce serait vous priver de temps pour vous précipiter dans votre librairie et vous plonger dans ce livre, qui vaut autrement le détour que mes bafouilles. Amateurs de bon polar, de bon roman historique, de bons livres tout simplement, vous voilà avertis : La République des faibles est l’un des livres à ne pas rater en ce début d’année.
Grâce à l’État de droit, la république s’enorgueillissait de protéger les faibles, surtout les enfants, et de les aider en cas de malheur. Il s’agissait de leur donner une chance de s’en sortir malgré un mauvais départ dans la vie. ici, tout le contraire, la pauvre Esther s’en prenait plein la gueule. Dans cette république dévoyée, les faibles buvaient le calice jusqu’à la lie.
P.S.: un dernier mot, encore, pour la couverture, que je trouve très réussie. Pas un détail à mes yeux, car quand on aime les livres dans leur version physique, on s’attache forcément un peu à l’objet qui abrite le texte. Ici, c’est la couverture qui m’a fait sauter dans le livre à pieds joints. Bravo supplémentaire à l’éditeur sur ce point !
L’Ange rouge, de François Médéline


Éditions La Manufacture de Livres, 2020
ISBN 9782358876964
512 p.
20,90 €
À la nuit tombée, un radeau entre dans Lyon porté par les eaux noires de la Saône. Sur l’embarcation, des torches enflammées, une croix de bois, un corps mutilé et orné d’un délicat dessin d’orchidée.
Le crucifié de la Sâone, macabre et fantasmatique mise en scène, devient le défi du commandant Alain Dubak et de son équipe de la police criminelle. Six enquêteurs face à l’affaire la plus spectaculaire qu’ait connu la ville, soumis à l’excitation des médias, acculés par leur hiérarchie à trouver des réponses. Vite.
S’engage alors une course contre la montre pour stopper un tueur qui les contraindra à aller à l’encontre de toutes les règles et de leurs convictions les plus profondes.
Quand je lis ici et là qu’on compare François Médéline à James Ellroy ou Dennis Lehane, je tombe des nues. Surtout le deuxième, dont j’adule la finesse, l’intelligence, la maîtrise des personnages et le style puissant – autant de qualités absentes de L’Ange rouge.
Je n’en attendais pas moins avant de commencer ma lecture, mais j’en espérais un peu plus. Surtout que le roman se déroule à Lyon, mon chez-moi depuis cinq ans.
Espoirs déçus.
The French Connection
L’Ange rouge, c’est le fantasme du polar à la française, largement daubé par trop de visionnages de films plus ou moins merdiques. Ça pue l’inspiration mal digérée, le recyclage sans génie.
Le flic solitaire bien qu’il dirige une équipe (dont tous les membres sont aussi déglingués que lui, ça va de soi). Ancien cocaïnomane, toujours sur le fil. Méthodes de voyou, aucun respect pour les procédures, intellect douteux, hanté par le souvenir de son ex et le cerveau perpétuellement tiraillé par le sexe.
Apparemment, selon Médéline en tout cas, pour faire viril, faut coller des « pédés » et des « fellations » partout. C’est un genre. Pas le mien.
On est quelque part entre Jean Reno, Olivier Marchal et Gérard Lanvin. La part mélancolique du premier, le désespoir ombrageux du deuxième et la classe animale du troisième en moins.
Et vas-y que je balance des clichés à tour de bras. Les flics vulgaires et bas du front, qui voient des « homos » partout (et dans leur bouche, ça sonne tout de suite suspect, limite dérangeant).
On sort à la campagne, c’est forcément pour tomber sur des fins de race limite consanguins, qui t’accueillent à coups de fusil quand ils ne bavent pas à chaque mot qu’ils éructent.
Au chapitre 12, l’irruption d’une psychiatre remet soudain tout d’aplomb – pour mieux mitrailler de nouveaux poncifs à peine plus relevés que les précédents.
On découvre le profil d’un tueur en série tellement vu et revu que même les scénaristes hollywoodiens en mal d’inspiration refuseraient de s’abaisser à un truc pareil – même pour ébaucher une fausse piste. Et on ajoute des symboles religieux bien lourdingues, déjà vus déjà lus qui plus est.
Bon, je me dis qu’on est seulement dans le premier tiers du bouquin.
Et ça s’arrange, après ?
Pas vraiment. Disons qu’on s’habitue. On renonce au réalisme, à la logique, à la cohérence, et on se laisse porter par les pulsions auto-destructrices des protagonistes, en espérant trouver un peu de sens au bout du chemin.
Ellroy pour les nuls
Pour faire polar, Médéline recourt au style élusif. Phrases très courtes, grammaire minimaliste, reprises martelées des pronoms personnels (« elle fait ci. Elle dit ça. Elle sort. Elle revient. »)
Ça peut faire écriture, à condition d’avoir le sens du rythme. Médéline en manque. Au lieu d’être percutant, c’est lancinant, limite chiant. Au moins c’est rapide à lire. Mais pour le plaisir du verbe, on repassera.
Sans parler des tics, des expressions reprises jusqu’à écœurement (« j’ai calibré » pour dire « j’ai regardé » ou « j’ai jaugé », je n’en pouvais plus de lire cette phrase !) Et des répétitions qui, là encore, sont censées faire style, mais qui ne sont que de vagues copies sans âme de tournures et de choix lus chez d’autres.
Ellroy sait faire ça, oui. Ou, chez nous, Jérôme Leroy, par exemple. Ici, ça sonne faux, fabriqué.
Des raisons d’espérer ?
Du côté positif, je retiendrai tout de même la manière dont Médéline assume jusqu’au bout la spirale sombre de son histoire, lui offrant un dénouement violent et explosif, et un final tout en contraste émotionnel, assez réussi.
Je retiendrai également le formidable personnage de Mamy, capitaine et bras droit de Dubak, grande carcasse qui se goinfre de sucreries et est capable de passer de l’inertie totale à la brutalité la plus sauvage en une seconde. Pour reprendre le petit jeu de la comparaison avec les comédiens, l’ombre de Corinne Masiero n’est pas loin, et ça fait du bien.
À souligner aussi, l’excellente utilisation du paysage urbain, de son décor et de son histoire. Jusqu’à présent, Lyon n’avait pas de représentant digne de ce nom parmi les plumes de polar – à la manière d’un Izzo pour Marseille, Léo Malet ou Simenon pour Paris. De sacrées références, auxquelles je ne me risquerais pas à comparer François Médéline, vous l’aurez compris.
Néanmoins, en tant qu’auteur du cru, il se lance avec L’Ange rouge dans une série littéraire dont Lyon devrait être l’héroïne récurrente, et c’est une belle pierre à placer dans son jardin.
Étant donné mes souffrances à la lecture de ce roman, je ne suis pas sûr d’être au rendez-vous du suivant. Pas mon style, pas mon trip.
Néanmoins, je suis peut-être passé à côté de quelque chose, car L’Ange rouge a ses fervents supporters. Pour vous faire une idée, je vous invite donc à parcourir les avis élogieux des blogueurs ci-dessous… et de vous faire votre propre opinion en le lisant !
Nord-Est, d’Antoine Choplin

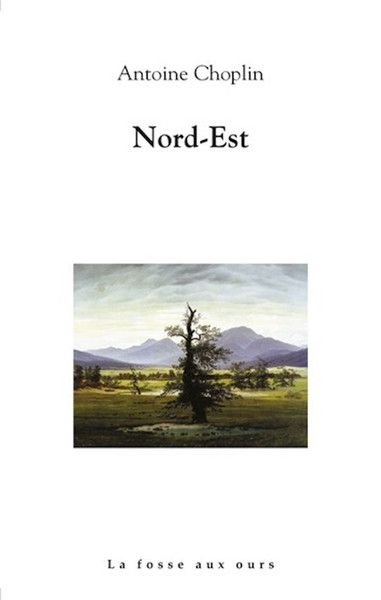
Éditions La Fosse aux Ours, 2020
ISBN 9782357071575
207 p.
18 €
RENTRÉE LITTÉRAIRE 2020
On a ouvert les portes. Rien n’empêche plus ces hommes et ces femmes de quitter le camp. Ils sont libres. La plupart restent là pourtant, espérant l’arrivée d’hypothétiques camions.
Quelques autres, sous l’impulsion du robuste Garri, entreprennent de partir à pied. Il s’agira pour eux de rejoindre les plaines du Nord-Est, là où il se pourrait que tout soit encore comme avant, et qu’une vie nouvelle puisse s’y reconstruire. Enfin, cela reste à vérifier.
En tout cas, avant cela, il faudra bien franchir les longs plateaux, les villages dévastés, et surtout, la barrière redoutable des hautes montagnes…
Pour décrire certains paysages particulièrement sauvages, on parle parfois de « beauté aride ». Cette expression pourrait être tout à fait appropriée pour qualifier le nouveau roman d’Antoine Choplin.
Dans Nord-Est, on retrouve le dépouillement cher à ce romancier discret, cette économie de moyens littéraires qui est sa marque de fabrique. Chez lui, tout est dans la retenue et l’esquisse. Les sentiments, les descriptions, la vie intérieure des personnages, leur parcours et leur histoire, mais aussi – on y revient – les paysages, ou le cadre de l’intrigue.
Des lieux, on ne sait rien de précis. Aucune référence géographique avérée – pas besoin. Les décors dont Antoine Choplin a besoin tiennent debout tout seuls. Ils existent dans l’imaginaire de n’importe quel lecteur, ils peuvent paraître familiers à n’importe qui, et le romancier leur donne forme et réalité par la seule force de son écriture et de sa puissance d’évocation.
Au cœur du récit, il y a des montagnes, si chères à l’écrivain, arpenteur de sentiers, grimpeur de pierriers, grand amoureux des parois verticales. La minéralité de ces paysages qu’il aime tant contamine son style et son propos. Tout est brut dans Nord-Est : le caractère bourru des personnages, leur parole (délivrée sans mise en forme, sans tiret ni guillemets), les liens qui les unissent.
Du reste, c’est toute l’intrigue qui est conçue comme une ascension. Il suffit de lire le titre des parties qui composent le roman. « Le plateau », « la montagne », « les plaines ». Nord-Est est l’histoire d’une élévation, et d’un franchissement. Il faut s’élever pour s’affranchir – de l’oppression, du poids de la souffrance, de ce qui nous ligote à nos peurs et à nos douleurs.
Peu à peu, Garri, Tayna et les autres se délestent, au contact de la pierre, de ce qui les retient à leur passé. Celui-ci se dévoile par bribes, au hasard de récits ou de souvenirs égrenés par l’un ou l’autre, lorsque le besoin s’en fait sentir.
Ce que le lecteur apprend alors est suffisant, pour les comprendre, les cerner. Et, petit à petit, les aimer, cachés derrière leurs silences et leurs paroles de peu, leurs gestes mesurés et leur manière d’affronter leur périple.
Sans jamais avoir besoin d’être décrits de manière exhaustive, ils s’habillent de minuscules détails qui leur donnent magnifiquement vie. Garri, solide et charismatique. Emmett, simple et solaire. Saul, le poète muet volontaire. Jamarr, sombre, sanguin mais solidaire. Tayna, courageuse et généreuse, accrochée à ses espoirs. Ruslan, quêteur obsessionnel de pétroglyphes, mystérieuses marques gravées dans la pierre des montagnes…
Du moment de l’intrigue on ignore également tout. Pas de période historique tirée de notre chronologie, ce n’est pas le propos. Tout comme nous ne saurons rien de ce qui a conduit tous ces gens dans un camp, durant tant d’années. Rien, des origines de la violence, des sources de la tyrannie manifeste qui a réduit ce pays inconnu en cendres, et ses habitants à l’état de prisonniers. Encore une fois, ce n’est pas le sujet.
Ce qui compte, c’est le chemin qui s’ouvre après tout cela. C’est la marche vers un retour à la vie.
Nord-Est n’est pas un livre historique, ni une dénonciation d’horreurs passées, ni quoi que ce soit de ce genre. C’est un roman d’âmes, quelques hommes et une femme, acharnés à rêver une vie meilleure et à se construire une rédemption.
Le livre n’est pas long (200 pages – même si, pour Choplin, habitué des textes brefs, c’est déjà une belle petite somme), mais il faut prendre le temps de s’y installer. De trouver des échos dans sa langue minimale, de cerner ses caractères tenaces et taiseux.
C’est au prix de cette patience, de cet effort, que l’émotion naît progressivement, et que le roman marque l’esprit de son empreinte.
À première vue : bonus !

Intérêt global :

Il y en a un peu plus, je vous le mets quand même ?
Allez, comme promis, j’ajoute une chronique à cette copieuse édition 2020 de la rubrique « à première vue », afin de mettre en lumière quelques éditeurs faisant le pari, par choix ou par contrainte économique, de ne lancer qu’un seul titre dans la rentrée littéraire.
Une parcimonie qui ne doit pas être entendue comme synonyme de pauvreté, mais au contraire comme une vraie prise de risque, et aussi la volonté de défendre coûte que coûte un texte et son auteur.
Par contraste avec le surplus parfois nonchalant de certains éditeurs, cet engagement fait du bien, et mérite d’être mis en valeur.
 ÉDITIONS DU SONNEUR
ÉDITIONS DU SONNEUR
Le Sanctuaire, de Laurine Roux
Tiens, ben voilà, démonstration par l’exemple : voici l’une de mes plus grosses attentes de la rentrée. Car le premier roman de Laurine Roux, Une immense sensation de calme (2018), était un diamant brut, taillé dans la plus minérale des roches littéraires.
Le résumé de ce deuxième livre semble un écho troublant, et en même temps excitant, de ce premier essai. Le Sanctuaire, c’est une zone montagneuse et isolée, dans laquelle une famille s’est réfugiée pour échapper à un virus transmis par les oiseaux et qui aurait balayé la quasi-totalité des humains. Le père y fait régner sa loi, chaque jour plus brutal et imprévisible.
Munie de son arc qui fait d’elle une chasseuse hors pair, Gemma, la plus jeune des deux filles, va peu à peu transgresser les limites du lieu. Mais ce sera pour tomber entre d’autres griffes : celles d’un vieil homme sauvage et menaçant, qui vit entouré de rapaces. Parmi eux, un aigle qui va fasciner l’enfant…
 LA FOSSE AUX OURS
LA FOSSE AUX OURS
Nord-Est, d’Antoine Choplin
Très connue dans la région lyonnaise où elle est implantée, la Fosse aux Ours compte à son catalogue quelques auteurs remarquables (Marco Lodoli, Thomas Vinau, Philippe Fusaro, Jacky Schwartzmann ou Mario Rigoni Stern), qui lui valent régulièrement d’être lue partout ailleurs en France – et tant mieux ! Parmi ces écrivains précieux figure Antoine Choplin, plume dont le minimalisme poétique nous a donné les superbes Radeau, La Nuit tombée ou Une forêt d’arbres creux, entre autres exemples.
Nord-Est, son nouveau livre, nous amène dans un camp, dont des hommes et des femmes ont enfin le droit de partir. Si la plupart restent sur place, d’autres décident de partir à pied. Ils veulent rejoindre les plaines du Nord-Est pour y reconstruire une nouvelle vie. Il leur faudra franchir des plateaux, des villages dévastés et de hautes montagnes…
 VIVIANE HAMY
VIVIANE HAMY
Efface toute trace, de François Vallejo
Éditrice historique de Fred Vargas, qui compte aussi à son prestigieux catalogue Dominique Sylvain, Cécile Coulon, Gonçalo M. Tavares, Léon Werth, Magda Szabo et tant d’autres, Viviane Hamy est l’une des grandes figures de l’édition française. Elle a su garder sa maison debout contre vents et marées, et si cette grande dame est aussi connue pour son caractère imposant (pour ne pas dire difficile), elle pratique avec certains de ses écrivains une fidélité et une foi à toute épreuve.
François Vallejo est dans ce cas, qui figure sur la ligne de départ de la rentrée littéraire avec constance depuis des années. Il est encore au rendez-vous cette année, avec une intrigue à suspense dans le monde de l’art.
Une série de meurtres frappe de riches collectionneurs. Pris de panique, les membres de leur groupe mandatent le narrateur, un expert, pour enquêter sur ces étranges incidents. Tout converge vers les créations d’un certain Jv. Ce dernier a dissimulé une véritable toile de maître dans une série de copies parfaites de chefs-d’œuvre destinées à être détruites. Au collectionneur de la reconnaître.
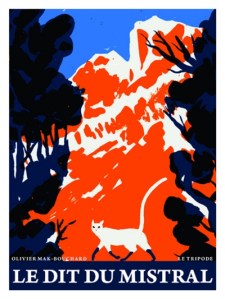 LE TRIPODE
LE TRIPODE
Le Dit du Mistral, d’Olivier Mak-Bouchard
Placer le Tripode à la suite de Viviane Hamy n’est pas tout à fait innocent de ma part, puisque son fondateur, Frédéric Martin, a fait une partie de ses classes auprès de la précédente. Une rupture professionnelle compliquée et une première tentative d’indépendance difficile (Attila) plus tard, il a imposé son Tripode parmi les maisons dotées d’une patte singulière, attachés aux écrivains virtuoses, aux univers singuliers et aux voix puissantes, parmi lesquelles Goliarda Sapienza (d’abord éditée chez Viviane Hamy, avant que l’œuvre de la fantasque romancière italienne soit regroupée sous la marque Tripode), Juan José Saer, Valérie Manteau, Pierre Cendors, Edgar Hillsenrath, Jacques Abeille, ou encore Charlotte Salomon – la publication monumentale de l’œuvre de l’artiste restant sans doute le point d’orgue du travail remarquable de l’éditeur.
Entrer dans ce catalogue est donc tout sauf innocent. C’est le pari que tente Olivier Mak-Bouchard avec son premier roman, Le Dit du Mistral. Tout commence le lendemain d’une nuit d’orage, dont la violence a emporté un vieux mur de pierres sèches au milieu d’un champ, et révélé dans les décombres et la boue de mystérieux éclats de poterie. Deux hommes, voisins vivant chacun d’un côté du champ, décident de fouiller plus avant, se lançant dans une aventure qui va dépasser de très loin tout ce qu’ils pouvaient imaginer.
BILAN
Lecture certaine :
Le Sanctuaire, de Laurine Roux
Lectures très probables :
Nord-Est, d’Antoine Choplin
Le Dit du Mistral, d’Olivier Mak-Bouchard
The Whites, de Richard Price
RETROUVEZ RICHARD PRICE AU FESTIVAL QUAIS DU POLAR A LYON, DU 1er AU 3 AVRIL 2016
Signé Bookfalo Kill
Billy Graves est chef d’une équipe de nuit du NYPD – un placard dont il a hérité après une bavure involontaire, qui a ruiné sa carrière de jeune flic prometteur. Il s’efforce depuis de faire au mieux en assurant chaque nuit la sécurité de ses concitoyens, tout en s’occupant de ses deux enfants, de sa femme et de son père qui perd gentiment la boule.
Un soir, un appel fait basculer ce train-train trop paisible : il reconnaît, en une victime poignardée à mort dans le couloir d’un métro, le « white » d’un de ses anciens collègues. Un « white », c’est un individu que l’on sait coupable d’un crime pour lequel on n’a pas réussi à le faire condamner, le laissant vivre depuis dans un état d’impunité qui pèse lourdement sur la conscience du policier désavoué. Hasard ? Lorsque, quelques jours plus tard, un autre « white » de ses collègues est retrouvé mort, Billy comprend que quelque chose se trame… en rapport, peut-être, avec cet individu mystérieux qui se met à suivre de trop près ses proches ?
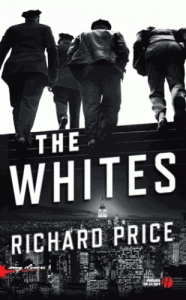 Œuvrant également comme scénariste (il a signé notamment quelques épisodes de la mythique série The Wire), Richard Price est vraiment un romancier trop rare. En France, sa dernière parution, Frères de sang, remonte à 2010, et encore était-ce la traduction d’un livre paru aux États-Unis en… 1976. Le précédent, le sublime Souvenez-vous de moi, datait de 2009 (2008 aux USA). Autant dire que voir débarquer un nouveau titre est une bonne nouvelle, surtout quand le roman en question est une belle réussite.
Œuvrant également comme scénariste (il a signé notamment quelques épisodes de la mythique série The Wire), Richard Price est vraiment un romancier trop rare. En France, sa dernière parution, Frères de sang, remonte à 2010, et encore était-ce la traduction d’un livre paru aux États-Unis en… 1976. Le précédent, le sublime Souvenez-vous de moi, datait de 2009 (2008 aux USA). Autant dire que voir débarquer un nouveau titre est une bonne nouvelle, surtout quand le roman en question est une belle réussite.
Dans The Whites, on retrouve tout ce qui fait la marque de fabrique de Richard Price, en commençant par son habileté prodigieuse à restituer les détails du quotidien, à immerger le lecteur sans l’ennuyer dans la vraie vie des gens ; ici son pivot est un policier, dont il relate non seulement l’enquête principale, celle qui sert d’intrigue centrale au roman (avec cette notion très intéressante de « white », joliment exploitée), mais aussi les autres interventions, avec un souci épatant du réalisme, et un joli mélange d’humour et de désenchantement.
New York est là aussi, poumon de son œuvre, surtout vue de nuit cette fois, spécialité de son enquêteur oblige. On y ajoute la profondeur des personnages, leur humanité tout en contraste (mention spéciale aux membres de la famille de Billy Graves, tous épatants, et à ses anciens collègues, sidérants) ; un suspense qui va crescendo, tendu surtout par l’intrigue parallèle centrée sur Milton Ramos, un autre flic dont les objectifs et le caractère deviennent de plus en plus inquiétants au fil des pages ; et une réflexion aussi clairvoyante que douloureuse sur les choix d’une vie, ainsi que la fidélité à ses convictions…
The Whites est sans aucun doute un très bon cru du romancier new yorkais, qui laisse des traces, impressionnant par son équilibre entre suspense et réalisme quasi documentaire des situations, sa maîtrise l’air de rien (la lecture est très fluide) et son empathie. Espérons que nous n’attendrons pas à nouveau sept ans pour avoir des nouvelles de Richard Price !
The Whites, de Richard Price
(The Whites, traduit de l’américain par Jacques Martinache)
Éditions Presses de la Cité, 2016
ISBN 978-2-258-11799-0
414 p., 22€
Le Fleuve guillotine, d’Antoine de Meaux
Signé Bookfalo Kill
La Révolution française ne s’est pas tenue qu’à Paris, comme l’Histoire telle qu’elle est enseignée en accéléré tend parfois à le laisser penser. De nombreuses provinces l’ont vécue également à leur manière ; c’est le cas de Lyon, qui s’est très vite élevée contre la ligne dure prônée par les Jacobins. Républicaine mais modérée, la Capitale des Gaules ne voulait pas de la Terreur. Elle l’a payée dans le sang et la fureur, violemment réprimée par la Convention.
 C’est ce que raconte Le Fleuve guillotine, gros roman historique d’une excellente facture, qui dresse avec un luxe de détails la reconstitution dans ces quelques mois, entre le 10 août 1792 (date de la chute de la royauté, pour ceux qui somnolaient contre le radiateur au fond de la classe) et la fin 1793. J’ignorais ainsi totalement que Lyon, après s’être ralliée aux Girondins et avoir éliminé les leaders montagnards envoyés dans la ville par la Convention, avait fait l’objet d’un siège en règle, durant deux mois, d’août à octobre 1793, avant de céder, affamée et pilonnée.
C’est ce que raconte Le Fleuve guillotine, gros roman historique d’une excellente facture, qui dresse avec un luxe de détails la reconstitution dans ces quelques mois, entre le 10 août 1792 (date de la chute de la royauté, pour ceux qui somnolaient contre le radiateur au fond de la classe) et la fin 1793. J’ignorais ainsi totalement que Lyon, après s’être ralliée aux Girondins et avoir éliminé les leaders montagnards envoyés dans la ville par la Convention, avait fait l’objet d’un siège en règle, durant deux mois, d’août à octobre 1793, avant de céder, affamée et pilonnée.
Avec beaucoup d’énergie et une belle verve, notamment dans les dialogues, Antoine de Meaux plonge quelques personnages solidement campés dans ce tourbillon effarant. Il évoque avec autant de précision les batailles de rue et les grands moments historiques (l’ouverture du roman, qui relate la reddition de Louis XVI à Paris, est ainsi une entrée en matière parfaite) que les soubresauts politiques et les errances de ses héros, confrontés à des choix bien trop grands pour eux, mais qui tous affrontent leur destin en affirmant des caractères que le contexte hors norme exacerbe.
Les lecteurs peu familiers de géographie lyonnaise trouveront en fin de volume plusieurs cartes joliment dessinées, qui plantent les grands lieux du récit autant que de la région où il se déroule. Une initiative qui s’avère fort utile, car de la sorte on plonge dans l’intrigue au plus près des pavés, de la superbe place Bellecour – si riche qu’elle sera symboliquement détruite par les Conventionnels après la chute de la ville – à l’Hôtel de Ville, de la Saône au Rhône, le fameux « fleuve guillotine » du titre, ainsi nommé car un certain nombre de condamnés furent exécutés sur le pont Morand, et leurs corps balancés directement dans l’eau… Ah ça, oui, on savait s’amuser à l’époque !
Le Fleuve guillotine, d’Antoine de Meaux
Éditions Phébus, 2015
ISBN 978-2-7529-1031-8
446 p., 23€
Quand le Diable sortit de la salle de bain, de Sophie Divry
Signé Bookfalo Kill
Sophie Divry est un cas d’école. Mais si, vous savez, ce genre d’auteurs dont on perçoit le talent brut, capable de fulgurances sidérantes qui vous clouent au fauteuil tant elles entrent en résonance avec certains de vos sentiments les plus intimes – mais qui, par paresse, par manque de travail, noient ces moments merveilleux dans un océan de nonchalance.
 Son nouveau roman, Quand le Diable sortit de la salle de bain, est un exemple implacable de ce constat. Au premier degré, c’est-à-dire dans la majeure partie du livre, c’est une comédie rigolote, narrant le quotidien étriquée de Sophie (tiens), jeune romancière lyonnaise (tiens tiens) qui tire le diable par la queue (parfois littéralement, donc, comme le titre le suggère) depuis qu’elle a quitté le monde du travail par la petite porte du licenciement qui fait mal. Elle fait l’expérience de la faim, compte le moindre centime – surtout quand elle n’en a plus un seul -, se perd dans les méandres de processus administratifs abscons pour tenter de récolter quelques maigres aides, élabore des combines minables et entame une carrière de serveuse maladroite.
Son nouveau roman, Quand le Diable sortit de la salle de bain, est un exemple implacable de ce constat. Au premier degré, c’est-à-dire dans la majeure partie du livre, c’est une comédie rigolote, narrant le quotidien étriquée de Sophie (tiens), jeune romancière lyonnaise (tiens tiens) qui tire le diable par la queue (parfois littéralement, donc, comme le titre le suggère) depuis qu’elle a quitté le monde du travail par la petite porte du licenciement qui fait mal. Elle fait l’expérience de la faim, compte le moindre centime – surtout quand elle n’en a plus un seul -, se perd dans les méandres de processus administratifs abscons pour tenter de récolter quelques maigres aides, élabore des combines minables et entame une carrière de serveuse maladroite.
Surgissant dans le récit sans invitation, les voix de sa mère et de son meilleur Hector, obsédé sexuel notoire, parasitent souvent ses efforts de normalité, l’aidant parfois aussi, un peu, à affronter la folie du quotidien…
Dans ce roman « improvisé et interruptif », selon les termes de Sophie Divry elle-même qui suit avant tout le fil de sa fantaisie, il y a de bons moments, pas mal d’humour, mais aussi d’atroces facilités et quelques dérapages crus ou vulgaires vraiment pas indispensables. Sans vouloir paraître exagérément prude, les trois pages d’ébats sexuels frénétiques de l’ami Hector, rapportés avec un luxe de détails équivalant à nombre de gros plans explicites dans une production Marc Dorcel, sont aussi balourdes que gratuites. (Pour tout dire, ce passage m’a amusé, mais ça ne plaira vraiment pas à tout le monde.)
Et puis, il y a ces fulgurances que j’évoquais en début d’article, ces uppercuts jaillis de nulle part qui vous sonnent d’autant plus que vous ne les avez pas vu venir. On en déniche quelques-unes dans ce roman, dont deux extraordinaires à la fin des deux premières parties, qui vous laissent K.O. pour le compte.
Comme un extrait parle mieux qu’un long discours, je vous laisse en guise de conclusion avec ce passage de la fin de la première partie, lorsque la narratrice raconte la première fois qu’elle a vu pleurer son père, alors qu’elle avait neuf ou dix ans :
« Une larme se détacha de la joue de mon père et tomba sur le sol. Alors un vent terrible se leva. Dans un souffle long comme le destin, il emporta le toit du château, il emporta les tilleuls, il emporta les farfadets et les soirées crêpes ; les boiseries se fendirent, les cheminées disparurent, les miroirs s’effacèrent, les chevaux s’échappèrent du pré, les chênes et les pins chutèrent avec fracas ; la terre trembla plus fort, mes frères grandirent ; disparurent les chasses au trésor, les petites souris de la dent de lait, les pics éveiches et les choucas (…)
Quand la terre eut fini d’absorber la larme de mon père, les barrières du parc qui ceignaient mon enfance s’étaient effondrées. Ne restait qu’une terrasse où mangeait une famille. Je ne vivais pas dans un vaste domaine aux greniers magiques, j’étais une enfant de classe bourgeoise dans une périphérie rurale d’un vieux pays industriel. « C’est normal », avait dit ma mère. J’étais une enfant normale dans une école normale, j’avais des notes normales que je ramenais à des parents normaux qui signaient normalement mon carnet normal (…) Quelques années plus tard, mon père tomba malade et mourut. Le tabac. La fatigue. C’est normal. »
Quand le Diable sortit de la salle de bain, de Sophie Divry
Éditions Notabilia, 2015
ISBN 978-2-88250-384-8
310 p., 18€
Profession du père, de Sorj Chalandon
Signé Bookfalo Kill
Ne le répétez surtout pas, mais le père d’Emile est agent secret. Il a aussi été pasteur pentecôtiste, footballeur professionnel, co-fondateur des Compagnons de la Chanson (mais il a quitté la troupe car sa voix exceptionnelle dominait trop celle des autres), ceinture noire de judo, résistant pendant la guerre bien sûr. Son meilleur ami, Ted, le parrain d’Emile, fait partie de la CIA.
André Choulans a surtout été un proche du général de Gaulle. Pour tout dire, homme de l’ombre discret et efficace, il avait son oreille, et nombre des décisions du Président étaient de son fait. Mais pas la dernière en date. Abandonner l’Algérie, ça non, André Choulans est contre. Son ami de Gaulle l’a trahi. Au nom de l’OAS, au nom des Français d’Algérie, il faut donc l’éliminer. Et pour cela, Émile va devoir faire partie de la conspiration. A treize ans, c’est une lourde responsabilité…
 Quel roman encore une fois, quel roman ! Car Profession du père est un roman, bien entendu. C’est écrit sur la couverture, et la qualité littéraire du texte, son inventivité, son humour, son émotion, la profondeur de ses personnages, sa construction, sont autant de preuves de sa vitalité romanesque. Mais il est impossible d’oublier que tous les livres de Sorj Chalandon portent sa marque personnelle, viennent de sa propre vie. C’est ce qui fait leur sincérité et leur puissance dévastatrice, qui me touchent à chaque fois – et cette fois, d’une manière plus intime et plus douloureuse.
Quel roman encore une fois, quel roman ! Car Profession du père est un roman, bien entendu. C’est écrit sur la couverture, et la qualité littéraire du texte, son inventivité, son humour, son émotion, la profondeur de ses personnages, sa construction, sont autant de preuves de sa vitalité romanesque. Mais il est impossible d’oublier que tous les livres de Sorj Chalandon portent sa marque personnelle, viennent de sa propre vie. C’est ce qui fait leur sincérité et leur puissance dévastatrice, qui me touchent à chaque fois – et cette fois, d’une manière plus intime et plus douloureuse.
Oui, Émile, c’est Sorj enfant. Un gamin lyonnais sous la coupe d’un père tyrannique, souvent violent, mythomane compulsif. Un père acteur d’un spectacle permanent dont il prend le monde à témoin. À la fois bourreau et modèle, source d’inspiration et de terreur. Capable d’embrigader son fils unique en oubliant que c’est un enfant, et qu’un enfant, mieux que quiconque, est capable de s’emparer d’un imaginaire pour en faire une réalité.
Car au-delà de ce portrait de père fascinant jusque dans ses pires extrêmes, il y a le regard de ce jeune garçon, confiant malgré tout, prêt à tout accepter parce que c’est son père et qu’il est son fils. Sorj Chalandon rend merveilleusement compte de cet état de crédulité aveugle qui est une forme d’amour absolue, dépassant la cruauté jusqu’à l’incompréhensible.
Avec un style plus dépouillé que jamais, moins lyrique que dans ses précédents romans (le sujet plus intime s’y prête moins), Chalandon réussit cet équilibre fragile entre émotion et violence, humour et souffrance, faisant d’Émile le réceptacle de frustrations et d’incompréhensions immenses.
Car si le père est au cœur du livre, il ne faut pas oublier la mère, personnage ô combien complexe, soumise mais détachée, aimant son mari malgré tout, malgré le mépris, les insultes, les coups qui parfois l’accablent elle aussi ; aimant également son fils mais ne comprenant pas ce qu’il subit, trop pragmatique, trop terre-à-terre. Dans la dernière partie du roman, c’est sa figure qui prend le dessus, déchirante, bouleversante, complétant le tableau d’une famille dysfonctionnelle, pourtant pas si éloignée de la plupart des nôtres – ce qui nous la rend si cruellement familière.
Profession du père est un beau roman tragique qui n’oublie pas d’être humain.
Profession du père, de Sorj Chalandon
Éditions Grasset, 2015
ISBN 978-2-246-85713-6
316 p., 19€
A première vue : la rentrée Stock 2015
Pour sa troisième année à la tête de Stock, l’éditeur Manuel Carcassonnne propose une rentrée solide quoique un peu trop riche (onze romans, neuf français et deux étrangers), où des valeurs sûres de la maison accueillent deux premiers romans, dont un aura sûrement la faveur des médias, et quelques transfuges aux noms prestigieux, dont le Britannique Nick Hornby et le romancier-psychanalyste Tobie Nathan.
 DANS MON ARBRE IL Y A… : La Cache, de Christophe Boltanski
DANS MON ARBRE IL Y A… : La Cache, de Christophe Boltanski
Si son nom vous est familier, ce n’est pas un hasard. Grand reporter au Nouvel Obs, Christophe Boltanski est aussi le fils du sociologue Luc Boltanski et le neveu de l’artiste Christian Boltanski. Ces précisions ont un sens, puisque c’est l’histoire de sa drôle de famille que livre ici le néo-romancier, en articulant son récit autour des pièces de la maision familiale à Paris. Le point de départ : la cache, un réduit minuscule où son grand-père s’est caché des Allemands durant la Seconde Guerre mondiale, et qui est devenu par la suite le point névralgique de la demeure. La presse sera probablement au rendez-vous de ce gros premier roman.
 RACINES : Nous serons des héros, de Brigitte Giraud
RACINES : Nous serons des héros, de Brigitte Giraud
Joli titre pour le nouvel opus de la romancière lyonnaise, qui relate l’arrivée en France d’une femme et de son jeune fils, Olivio, tous deux ayant fui la dictature portugaise. Recueillis par un rapatrié d’Algérie, ils espèrent un nouveau départ mais l’homme ne supporte pas l’adolescent. Celui-ci se lie d’amitié avec Ahmed, un immigré algérien de son âge… Un roman où amours, tensions et quêtes de soi et de son identité seront au cœur du récit.
 POMME TOMBÉE DE L’ARBRE : Eva, de Simon Liberati
POMME TOMBÉE DE L’ARBRE : Eva, de Simon Liberati
Enfant, elle a posé nue pour sa mère, la photographe Irina Ionesco, souvent dans des poses érotiques qui ont fait scandale. Une expérience traumatisante qui a laissé des traces et a marqué durablement sa vie, entre jeunesse tumultueuse et procès retentissant contre sa génitrice. Depuis, récemment, elle est devenue la femme de Simon Liberati, qui lui consacre donc ce récit intime, après l’avoir croisé plusieurs fois au fil des années, et s’en être inspiré pour son premier roman alors qu’il ne la connaissait pas encore. Là aussi, presse attendue… pour de bonnes raisons, on espère.
 BRANCHES : Il faut tenter de vivre, d’Eric Faye
BRANCHES : Il faut tenter de vivre, d’Eric Faye
Sandrine Broussard non plus n’a pas eu la vie facile. De son enfance maltraitée, elle a eu l’idée de se venger en séduisant à la chaîne qu’elle arnaquait ensuite avant de disparaître, multipliant identités, vies et fuites. Depuis longtemps fasciné par cet femme insaisissable, le narrateur finit par la rencontrer et se lier à elle. Un roman autobiographique auquel Eric Faye tient beaucoup.
 INCENDIAIRE : Un homme dangereux, d’Emilie Frèche
INCENDIAIRE : Un homme dangereux, d’Emilie Frèche
Attention, sujet sensible. Ce roman met en scène un homme convainquant une femme de tout quitter, son mari et ses filles partis en Israël, pour vivre avec lui. Mais son véritable projet est de la détruire, pour la seule raison qu’elle est juive… Une œuvre post-Charlie qui pourrait faire grincer des dents.
 PETIT POUCET PERDU DANS LA FORÊT DES SENTIMENTS : L’illusion délirante d’être aimé, de Florence Noiville
PETIT POUCET PERDU DANS LA FORÊT DES SENTIMENTS : L’illusion délirante d’être aimé, de Florence Noiville
L’illusion délirante d’être aimé est une véritable maladie, potentiellement dangereuse, connue sous le nom de « syndrome de Clérambault », du nom du psychiatre qui l’a diagnostiquée. L’héroïne de ce roman, Laura, en souffre, accusant une ancienne amie de la harceler. Sauf que personne dans son entourage n’est témoin de rien…
 CANOPÉE : Ce pays qui te ressemble, de Tobie Nathan
CANOPÉE : Ce pays qui te ressemble, de Tobie Nathan
Une grande fresque historique prenant pour cadre l’Egypte, dont est originaire Tobie Nathan. Suivant depuis longtemps une double carrière de psychanalyste réputé et de romancier, l’écrivain retrace à travers le parcours extraordinaire de Zohar, né dans le ghetto juif du Caire, l’histoire récente de son pays, depuis le roi Farouk jusqu’à l’islamisation grandissante de ces dernières années.
DÉRACINÉE : Sœurs de miséricorde, de Colombe Schneck
Une Bolivienne quitte son pays et sa pauvreté pour Paris, où elle espère gagner sa vie. Elle se heurte à une autre vision du monde, froide et désincarnée, notamment chez les riches qui l’emploient. Si ce roman est inspirée d’une rencontre qu’elle a faite, pour une fois Colombe Schneck ne parle pas d’elle. C’est déjà ça.
DÉRACINÉS : Les bannis, de Laurent Carpentier
C’est l’autre premier roman de la rentrée Stock. Inspiré de faits réels, il relate le bannissement, l’excommunication, l’exil et l’exploitation des membres d’une famille dans le tumulte du XXe siècle dans un texte qui oscille entre vie et mort, entre horreur et humour.
*****
 BOURGEONS : Funny Girl, de Nick Hornby
BOURGEONS : Funny Girl, de Nick Hornby
(traduit de l’anglais par Christine Barbaste)
Un grand nom de la littérature anglaise contemporaine rejoint Stock ! L’auteur de Carton jaune, Pour un garçon, Haute fidélité ou Juliet, Naked évoque les Swinging Sixties, à travers l’histoire d’une actrice, Sophie Straw, star d’une comédie à succès de la BBC dans les années 60. Un roman que l’on attend comme toujours enlevé, humain, chaleureux et drôle.
 RADICELLES : Avant la fête, de Sasa Stanisic
RADICELLES : Avant la fête, de Sasa Stanisic
(traduit de l’allemand par Françoise Toraille)
Ce n’est que le second roman de Sasa Stanisic, romancier d’origine yougoslave qui vit en Allemagne, et connut un gros succès avec son premier titre, Le Soldat et le Gramophone – c’était en 2008, déjà. Cette fois, il raconte un village et ses habitants, le temps d’une nuit, avant la fête de la Sainte-Anne, moment important de la communauté.
Un fantôme dans la tête, d’Alain Gagnol
Cher Alain Gagnol,
Je ne sais pas si vous lirez un jour cette chronique, mais permettez-moi de la commencer en m’adressant à vous, pour le mea culpa le plus sincère que je puisse exprimer. Je n’avais pas prévu de lire votre roman. Quand je l’ai vu arriver, le jour de sa sortie, j’ai soupiré devant sa couverture (pourtant plutôt pas mal), le nom de l’éditeur (circonstance atténuante, le Passeur avait publié précédemment le très mauvais « polar » de Francis Huster)… bref,je l’ai accueilli avec toute la mauvaise foi du monde et un a priori parfaitement injustifié.
Je l’ai pourtant pris, votre Fantôme, à l’occasion d’une pause déjeuner, avec l’idée de conforter ma mauvaise opinion toute faite en en lisant quelques pages d’un œil dubitatif, avant de le reléguer dans un coin et de l’oublier aussitôt. En fait de quelques pages, j’en ai dévoré 80 d’un coup. Scotché, séduit, irrémédiablement happé. Je l’ai fini hier soir, à regret ; et me voici donc aujourd’hui sur ce blog pour vous dire, à vous Alain, et à vous tous chers amis Cannibales, à quel point je me suis régalé avec ce livre.
 Un fantôme dans la tête, c’est l’histoire de Marco Benjamin, lieutenant de police à Lyon de son état, chargé de mettre fin aux crimes atroces d’un tueur en série qui kidnappe des jeunes femmes pour les dépecer bien salement dans des entrepôts déserts ou des cabanes abandonnées. Le jour où il retrouve une nouvelle victime assez vite pour recueillir son dernier souffle, son esprit cède – et les ennuis s’abattent.
Un fantôme dans la tête, c’est l’histoire de Marco Benjamin, lieutenant de police à Lyon de son état, chargé de mettre fin aux crimes atroces d’un tueur en série qui kidnappe des jeunes femmes pour les dépecer bien salement dans des entrepôts déserts ou des cabanes abandonnées. Le jour où il retrouve une nouvelle victime assez vite pour recueillir son dernier souffle, son esprit cède – et les ennuis s’abattent.
Entre son divorce tout frais, sa fille de 16 ans qui le supplie de lui laisser prendre la pilule, une autre gamine à peine majeure qui fugue et s’installe de force dans son canapé, un gourou voyant, adoubé par la femme du préfet, qui prétend pouvoir aider la police, et l’IGS fascinée par la maestria avec laquelle il multiplie les manquements au règlement, Marco n’a que l’embarras du choix pour nourrir sa dépression. Au point que, grand fan de comics, il finit par s’imaginer un alter ego, Suicide-Man, le super-héros qui n’arrive jamais à mourir. Un double de lui-même qui, affublé d’un vieux tee-shirt de Superman, pourrait bien réaliser quelques prouesses inédites…
Arrivé à ce stade de la chronique, soit vous n’êtes déjà plus là et c’est dommage, soit vous vous dites : « pfff, c’est du déjà-vu tout ça », soit vous pensez « pfff, mais qu’est-ce que c’est que ce micmac ?!? » (soit vous êtes déjà parti vers votre librairie préférée pour l’acheter, et là je dis juste bravo).
Non, sérieusement, pourquoi ce polar fonctionne aussi bien ? Parce qu’il a un ton, un humour franc et une vraie chaleur humaine, en dépit des horreurs qu’il peut exprimer par ailleurs. Un fantôme dans la tête est à la fois un thriller glaçant et une comédie réjouissante. Comment est-ce possible ? Aucune idée, c’est le secret de fabrication d’Alain Gagnol, mais diable, le monsieur est doué pour cela.
En fait, bien que construit sur une trame au final assez simple, Un fantôme dans la tête aligne les bons rebondissements et les séquences délicieuses ou inattendues avec la régularité d’un chef d’orchestre dirigeant le Boléro de Ravel. Voir les scènes hilarantes chez le psy, que Marco finit par rendre fan absolu de comics à force de lui en parler (plutôt que d’évoquer ses propres problèmes), ou celles avec l’IGS, dont les membres se comportent en groupies de Marco, persuadés de tenir une légende tellement improbable qu’ils préfèrent le laisser agir n’importe comment plutôt que de l’arrêter.
Si vous avez envie de vous marrer un bon coup avec un polar dont l’intrigue tient proprement la route, si vous aimez les dialogues qui claquent, les baffes dans la gueule tendance bourre-pifs à la Audiard, les super-héros un peu nuls, les filles insolentes et les personnages déjantés, faites une petite place dans votre tête pour ce Fantôme. Vous serez, je l’espère, aussi agréablement surpris que je l’ai été !
Signé Bookfalo Kill
Un fantôme dans la tête, d’Alain Gagnol
Éditions le Passeur, 2014
ISBN 978-2-36890-136-6
354 p., 20,90€
La Toile bruisse déjà d’avis favorables sur ce roman : le blog de Yv, Blue Moon… en espérant que ce ne soit que le début !

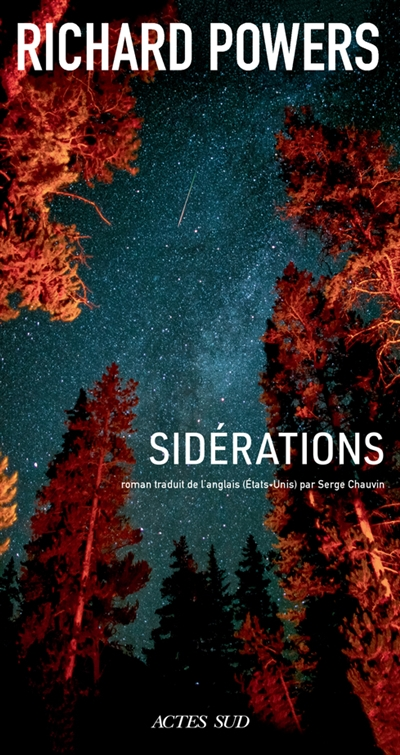
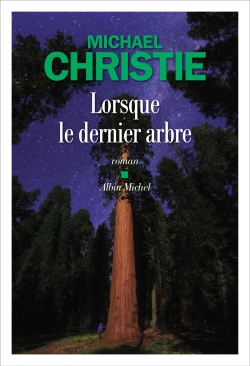
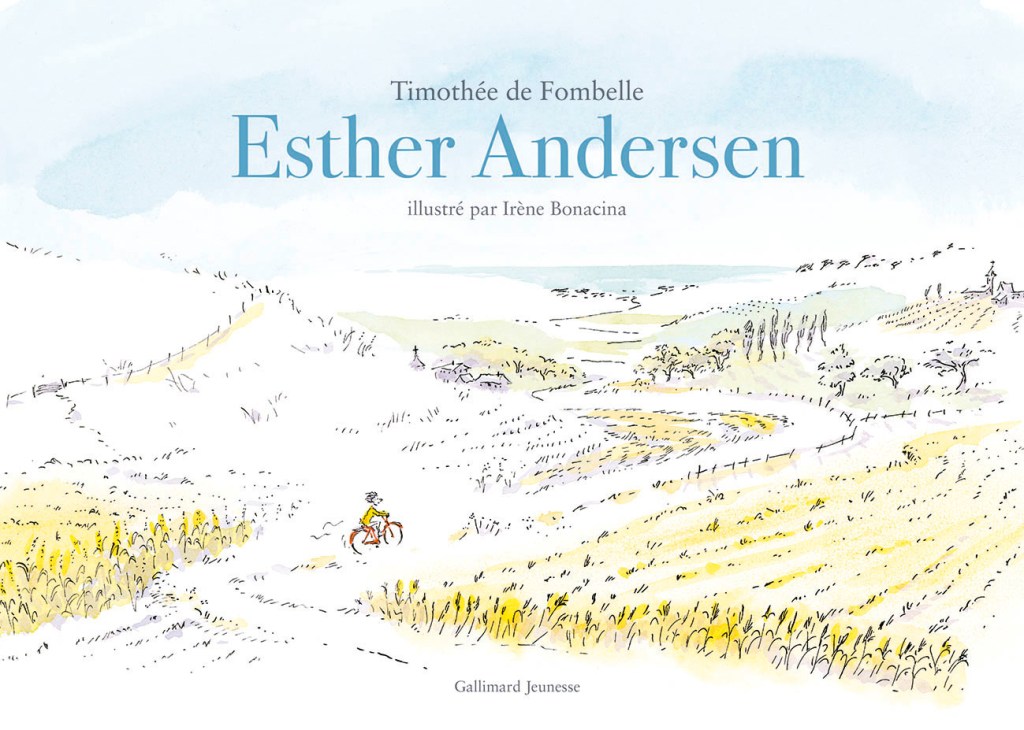


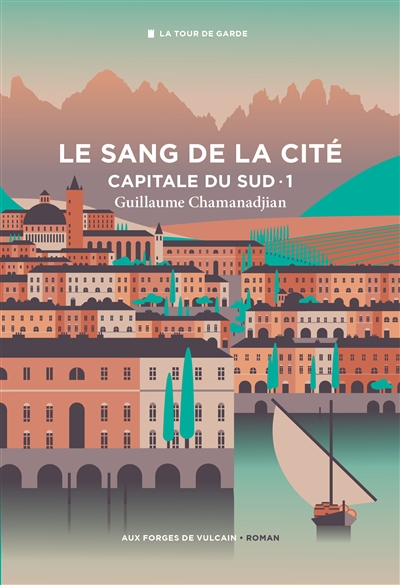





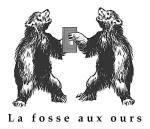



 ALGÉRIE I :
ALGÉRIE I : ALGÉRIE II :
ALGÉRIE II : DARDENNE :
DARDENNE : BLOB :
BLOB : JEAN LE CARRE :
JEAN LE CARRE : URANUS :
URANUS : DÉBRANCHE :
DÉBRANCHE : WE TAKE CARE OF OUR OWN :
WE TAKE CARE OF OUR OWN : INTÉRIEUR NUIT :
INTÉRIEUR NUIT : HOMÉRIQUE :
HOMÉRIQUE :