Complément d’enquête #1 : Eric Vuillard
Nouvelle rubrique aujourd’hui sur le blog, dans le même esprit que les rapports d’enquête : l’idée du complément d’enquête est d’ajouter, à un article récent sur un auteur, quelques chroniques rapides sur les livres précédents de l’écrivain en question.
Et on commence donc avec Eric Vuillard, qui n’avait eu droit qu’à un seul article avant celui d’hier. Un scandale, qu’il convient de réparer au plus vite.
Tous les livres évoqués ci-dessous sont disponibles aux éditions Actes Sud, dans la collection de poche Babel, à l’exception de La Guerre des pauvres, pas encore sorti dans ce format. Les dates entre parenthèses sont celles de la première parution en grand format du texte.
Congo (2012)
ISBN 978-2-330-03419-1
112 p.
6,70 €
« Le Congo, ça n’existe pas ». Il faut donc l’inventer : lui donner des frontières. Conduite par Bismarck, la conférence de Berlin en 1884, raout diplomatique international où les grandes puissances décident de l’avenir de l’Afrique tout entière, va sceller le sort de ce pays en donnant naissance à la colonie belge du Congo. Viennent alors le défrichage, les premières infrastructures, les massacres… On assiste aux manoeuvres de Léopold II, puis aux mésaventures de Charles Lemaire l’éclaireur, de Léon Fievez le tortionnaire, des frères Goffinet les négociateurs, etc.
À la fois roman historique et réflexion politique sur le libre-échange, déjà en germe à cette époque, Congo met en scène les balbutiements de l’époque coloniale pour dénoncer les travers de notre modernité.
Mon premier Vuillard. Pas sûr de l’avoir compris du premier coup, déconcerté que j’étais par la forme très particulière du texte, ni roman ni essai historique, quelque part entre les deux, dans un sillon que l’écrivain creuse depuis avec force et régularité.
Mais ce que j’ai retenu, puis retrouvé lors d’une seconde lecture quelques années plus tard, c’est la puissance d’indignation du style d’Eric Vuillard. Son art fatal de l’ironie dénonciatrice, aussi, qui cisaille avec violence les profiteurs, les abuseurs, les tortionnaires de l’Histoire. Et il y a de quoi faire avec cette sordide épopée de la colonisation africaine, en particulier au Congo sous l’épouvantable férule du roi Léopold II.
Un récit révoltant, d’une violence parfois insoutenable, dont le principal défaut est sans doute d’être trop court, et donc de survoler un peu trop un sujet pourtant complexe, qui aurait mérité quelques pages d’analyse en plus. Mais, après un Conquistadors trop gros et trop délayé, Vuillard affinait encore sa méthode, et Congo souffre un peu d’avoir servi de matrice aux textes suivants. Très intéressant tout de même.
La Bataille d’Occident (2012)
ISBN 978-2-330-03064-3
192 p.
8 €
« La Bataille d’Occident est l’un des noms de nos exploits imaginaires. C’est un récit de la Grande Guerre, celle de 14-18, où nos différentes traditions de « maîtres du monde » manifestèrent ouvertement leur grande querelle. Il en résulta un charnier sans précédent, la chute de plusieurs empires, une révolution. Et tout cela fut déclenché par quelques coups de révolvers ! »
Eric Vuillard revisite à sa manière historique, politique et polémique le premier conflit mondial.
Sans doute le texte d’Eric Vuillard qui m’a le moins marqué à ce jour, malgré deux lectures.
L’écrivain y a pourtant l’ambition de saisir les éléments déclencheurs de la Première Guerre mondiale, les étapes qui ont inéluctablement mené l’Europe puis le reste du monde à son premier conflit globalisé. Il est déjà fidèle à son projet de sortir des sentiers battus du récit historique classique, en croquant les portraits des protagonistes, en insistant sur leur ridicule, leurs obsessions délétères, leurs petites mesquineries si humaines qui ne figurent pas dans les manuels mais donnent ici un relief différent aux événements.
Comme Congo, paru simultanément, le livre manque sans doute de maîtrise dans son ensemble, mais mérite le coup d’œil par certains éclats de style jubilatoires.
(Bref, il faudrait que je le relise.)
Tristesse de la terre (2014)
ISBN 978-2-330-06558-4
176 p.
6,80 €
“Le spectacle est l’origine du monde.” Créé en 1883, le «Wild West Show» de Buffalo Bill proposait d’assister en direct aux derniers instants de la conquête de l’Ouest : au milieu de cavaliers, de fusillades et d’attaques de diligence, des Indiens rescapés des massacres y jouaient le récit de leurs propres malheurs. L’illusion était parfaite.
Par la force de la répétition et le charme de la féerie, le «Wild West Show» imposa alors au monde sa version falsifiée de l’Histoire américaine.
Un exemple du génie de Vuillard à l’œuvre dans ce texte : deux chapitres qui se répondent, à quelques pages d’intervalle. Le premier, intitulé « La bataille de Wounded Knee », relate la bataille en question telle qu’elle fut représentée durant le Wild West Show, et telle que la postérité américaine souhaite la conserver en mémoire – un affrontement épique, digne et grandiose, entre les colons et les Indiens, durant lesquels ces derniers, bien que défaits, obtinrent le respect de leurs adversaires par leur bravoure et leur héroïsme.
Le second, ensuite, rectifie le tir : la bataille devient « Le massacre de Wounded Knee ». Et relate comment, en fait d’affrontement épique, l’attaque se résuma à un traquenard minable, où les Indiens pris au piège furent massacrés sans autre forme de procès.
Réflexion éblouissante sur la naissance de la société du spectacle aux États-Unis, mais aussi sur les racines des mythes, la manière effroyable dont les colons évincèrent les Indiens de leurs terres et de leurs vies, Tristesse de la terre est un récit à la fois érudit, passionnant, clairvoyant, poignant, révoltant et poétique. L’un des plus beaux textes de Vuillard à mon avis.
14 juillet (2016)
ISBN 978-2-330-09611-3
208 p.
7,80 €
Mon préféré d’Eric Vuillard. Déjà chroniqué sur Cannibales Lecteurs, à lire ici : https://cannibaleslecteurs.com/2016/08/18/coup-de-coeur-14-juillet-deric-vuillard/
L’Ordre du jour (2017)
ISBN 978-2-330-15304-5
160 p.
6,80 €
20 février 1933 : une fin d’après-midi à Berlin, dans les confortables salons du Palais du président du Reichstag. Une réunion secrète entre les plus grands industriels allemands et les hauts dignitaires nazis doit sceller le financement de la prochaine campagne électorale. Il y a là “le nirvana de l’industrie et de la finance” : Krupp, Opel, Siemens, Telefunken… De cette scène inaugurale procède un consentement irréversible qui aboutira au pire.
Au fil d’un récit intense et sidérant, l’écriture d’Éric Vuillard rend à l’engrenage des faits leur dérisoire et pathétique charge émotionnelle, la fragilité de l’instant. Et derrière les images triomphales de la Wehrmacht se découvrent, aux origines, de vulgaires marchandages, de tristes combinaisons d’intérêt.
En règle générale, les parutions d’Eric Vuillard sont espacées de deux ans. Ce texte fait exception, qui paraît neuf mois après le précédent – ce que les fans du monsieur ont eu tout lieu de se réjouir, on ne lit jamais assez Vuillard.
Grand bien lui a pris, du reste, ainsi qu’à son éditeur, puisque L’Ordre du jour lui a valu le prix Goncourt, consécration à la fois réjouissante – il fallait tout de même oser l’attribuer à ce genre de livre inclassable – et méritée au regard de l’œuvre de l’écrivain, et de son obstination à mener sa barque à sa façon, sans jamais perdre son cap de vue.
Dans ce texte, Eric Vuillard s’emploie à désacraliser. Les plus grands industriels allemands, pour commencer, dont la plupart connaissent toujours une activité florissante aujourd’hui, et que l’on découvre ici mettant la main à la poche par pur opportunisme politique pour soutenir Hitler dans son accession à la chancellerie allemande, et donc au pouvoir – et donc à la route menant à la folie et à la destruction massive.
Désacralisation d’un événement ensuite, en relatant les véritables conditions dans lesquelles s’est déroulé l’Anschluss, la « conquête » de l’Autriche par l’Allemagne en 1938 – une invasion éclair dont chaque scène était écrite à l’avance, ce qui n’a pas empêché la machine de se gripper à l’occasion.
Grâce à sa redoutable ironie, Vuillard s’amuse à faire crouler le ridicule sur les acteurs d’une pantomime qui, si elle n’avait pas eu d’aussi terribles conséquences, serait purement risible.
Un livre assez complexe, mais dont la pertinence fait évidemment un bien fou au lecteur avide de voir son intelligence flattée.
La Guerre des pauvres (2019)
ISBN 978-2-330-10366-8
68 p.
8,50 €
1524, les pauvres se soulèvent dans le sud de l’Allemagne. L’insurrection s’étend, gagne rapidement la Suisse et l’Alsace. Une silhouette se détache du chaos, celle d’un théologien, un jeune homme, en lutte aux côtés des insurgés. Il s’appelle Thomas Müntzer. Sa vie terrible est romanesque. Cela veut dire qu’elle méritait d’être vécue ; elle mérite donc d’être racontée.
Les exaspérés sont ainsi, ils jaillissent un beau jour de la tête des peuples comme les fantômes sortent des murs.
Tout petit texte, certes (68 pages seulement), mais quel texte ! D’autant plus qu’il n’évoque pas seulement la figure de Thomas Müntzer, mais aussi celles d’un certain nombre de personnages similaires, notamment en Angleterre, qui ont tous, et sans se concerter (sans même se connaître d’ailleurs), décidé de mener des mouvements de révolte plus ou moins violents, toujours animés d’une véritable pensée en action, en réaction à la terrible oppression dont souffraient alors les peuples, écrasés de taxes et à la merci de seigneurs iniques.
C’est incroyablement fort, stimulant, et les liens qui se tissent sans jamais être énoncés avec certaines situations de notre époque font froid dans le dos. Encore un livre absolument essentiel, une spécialité d’Eric Vuillard en somme.
Une sortie honorable, d’Eric Vuillard
La guerre d’Indochine est l’une des plus longues guerres modernes. Pourtant, dans nos manuels scolaires, elle existe à peine.
Avec un sens redoutable de la narration, Une sortie honorable raconte comment, par un prodigieux renversement de l’histoire, deux des premières puissances du monde ont perdu contre un tout petit peuple, les Vietnamiens, et nous plonge au coeur de l’enchevêtrement d’intérêts qui conduira à la débâcle.
En remontant dans l’historique du blog, je m’aperçois avec horreur que je n’ai proposé qu’une seule chronique d’un livre d’Eric Vuillard. Dans la mesure où Vuillard est l’un de mes écrivains français favoris, que je ne raterais un nouveau livre de lui pour rien au monde, c’est un constat consternant – et auquel il faut remédier rapidement.
Commençons dès aujourd’hui, avec cette Sortie honorable qui fait honneur au talent et à la pertinence de cet auteur inimitable, tout en n’en faisant aucun à la France.
Et pour cause, il y est question de la guerre d’Indochine. Un conflit particulièrement navrant (on pourrait se demander quelle guerre n’est pas navrante, mais c’est un autre problème), que l’on résume souvent à son début – la déclaration d’indépendance lancée par Ho Chi Minh en 1945, étrangement mal reçue par le gouvernement tricolore – et à sa fin grotesque – la défaite de Dien Bien Phû, résultat d’un mouvement stratégique qui fera encore ricaner dans les écoles militaires des siècles à venir (en admettant que nous ne soyons pas tous morts avant d’une rafale de bombes atomiques en travers de la tronche, bien entendu).
En soi, un récit sur le sujet, ça ne paraît peut-être pas très sexy. Sauf que vous remettez votre temps de lecteur entre les mains d’Eric Vuillard, et que c’est une responsabilité qu’il prend très au sérieux. Les quelques deux cents pages que l’auteur vous offre en retour, pour paraître concises, n’en sont pas moins riches d’innombrables informations passionnantes, tout en s’avérant hilarantes, mordantes, révoltantes, grinçantes à souhait.
Le style Vuillard, en somme.
D’ailleurs, c’est quoi, ce fameux style Vuillard, qui lui a valu notamment un prix Goncourt ultra-mérité en 2017 pour L’Ordre du jour ? C’est un mélange de recherche historique pointue, de littérature virtuose (le sens de la formule de ce garçon, mon dieu, c’est une boîte de Quality Street à chaque page ou presque), et surtout un point de vue systématiquement original, décalé ; un regard sur l’événement historique qui prend le tableau de biais pour mieux le comprendre, ou au moins l’appréhender autrement.
Eric Vuillard n’est pas historien. Il ne se prétend pas tel. Il assume son statut d’écrivain, de manieur littéraire. C’est ce qui fait sa force – mais aussi sa limite pour ceux qui considèrent que l’Histoire est une chose trop sérieuse pour l’abandonner aux mains des scribouilleurs. Le point de vue s’entend. Vous aurez compris que je n’en ai rien à faire.
Vuillard est un homme de parti pris. Ça aussi, il l’assume. Ses convictions penchent à gauche, ce qui explique sa tendance naturelle à privilégier le côté des faibles, des opprimés, et à s’en prendre sans retenue aux décideurs, aux cyniques du pouvoir, sur lesquels il cogne avec une jubilation manifeste, qui se traduit par un maniement létal de l’ironie et un art de portraitiste qui n’est jamais loin de celui du caricaturiste, violent et cruel – des piques acerbes que les intéressés, en général, ont largement méritées.
Si l’on revient enfin au sujet du jour, il y a de quoi faire, et Eric Vuillard s’en donne à cœur joie. On commence avec les politiques, saisis lors d’une séance effroyable d’octobre 1950, lors de laquelle les parlementaires décident contre vents et marées la poursuite d’une guerre qui dure déjà depuis six ans et impose au pays un coût invraisemblable, en vies comme en argent.
On poursuit plus loin avec les militaires, superbe brochette d’arrogants à épaulettes, tellement sûrs de leur supériorité tactique et logistique qu’ils conçoivent de s’enfermer dans une cuvette (un « pot de chambre », raille l’auteur en verve) pour mieux y perdre tout seuls la fameuse bataille de Dien Bien Phû, achèvement logique d’une campagne désastreuse de bout en bout.
On termine, enfin, se croyant à bout de colère devant tant de gâchis assumé avec tant de suffisance, par une séance de conseil d’administration de la Banque d’Indochine, et l’on trouve encore la force de s’emporter en découvrant que les actionnaires de cette dernière, spéculant sur l’inévitable défaite, se sont garanti en 1954 les plus juteux dividendes de l’histoire de leur banque.

Pour nourrir son récit et ses réflexions, fidèle à ses habitudes, Eric Vuillard s’est appuyé sur des documents directs – compte-rendus de séance à l’Assemblée Nationale, de la réunion du conseil d’administration, archives… – qu’il met ensuite en scène, de manière très naturelle, grâce à son écriture toujours en alerte, et à un humour salvateur face à tant d’ignominie.
Il compose ainsi un tableau mouvant, dont les différentes facettes sont autant de réponses apportées à la problématique qui tend toute l’œuvre : à vouloir sauvegarder intérêts et apparences, y a-t-il seulement moyen de s’en sortir avec les honneurs ? La terrible ironie du titre résume avec sarcasme l’impossibilité de la chose et, en creux, les terribles conséquences que cette volonté de « sortie honorable » a eues sur tant de gens.
Cet écrivain surdoué, doublé d’un penseur dont le regard volontiers provocateur incite sans cesse à prendre ses responsabilités et à penser par soi-même, signe un nouveau brûlot essentiel dans ce style qui n’appartient qu’à lui, et qui nous a valu déjà nombre de merveilles littéraires. Eric Vuillard est un auteur nécessaire. Faites-vous du bien, lisez-le.
Une sortie honorable, d’Eric Vuillard
Éditions Actes Sud, 2022
ISBN 978-2-330-15966-5
208 p.
18,50 €
Atlas des terres sauvages


Avant d’aborder cet ouvrage en particulier, je voudrais profiter de l’occasion pour évoquer la collection dont il fait partie.
En 2010, les éditions Arthaud publient Atlas des îles abandonnées, de Judith Schalansky. Couverture cartonnée, édition reliée, pages colorées, format idéal pour un beau livre, textes inspirés et assortis de cartes graphiques du plus bel effet : triomphe aussi inattendu que mérité en librairie. Tant et si bien que la maison d’édition décide de récidiver trois ans plus tard, avec le tout aussi bluffant Atlas des lieux maudits, d’Olivier Le Carrer : même succès.
Depuis, Arthaud a largement décliné cette formidable idée d’atlas poétiques, dont vous pouvez retrouver l’intégralité des titres parus sur cette page dédiée de leur site Internet.
Certains titres sont plus réussis que d’autres – cela dépend sûrement des sujets, et de l’intérêt que l’on y prend. Mais la collection, dans sa globalité, est une invitation au voyage aussi excitante qu’originale.
Paru en 2019, le dernier-né s’intitule donc Atlas des terres sauvages. Aude de Tocqueville, déjà auteure de L’Atlas des cités perdues (2014), nous convie à l’exploration de territoires inaccessibles, oubliés, ou carrément hostiles, dont les noms même, souvent, ouvrent déjà les portes de la rêverie : la Tampoketsa d’Ankazobe, les îles Bonvouloir, les Tepuis de Jaua-Sarisarinama, le corridor du Wakhan…
 Mais on part aussi à la découverte de lieux aux noms plus familiers, dont Aude de Tocqueville raconte l’histoire, les spécificités, et quelques anecdotes frappantes. Bienvenue, donc, aux îles Lofoten, sur la Lune, au Point Nemo, à Tchernobyl… ou dans les souterrains de New York – pour ne citer que quelques destinations parmi les trente-six proposées dans le livre.
Mais on part aussi à la découverte de lieux aux noms plus familiers, dont Aude de Tocqueville raconte l’histoire, les spécificités, et quelques anecdotes frappantes. Bienvenue, donc, aux îles Lofoten, sur la Lune, au Point Nemo, à Tchernobyl… ou dans les souterrains de New York – pour ne citer que quelques destinations parmi les trente-six proposées dans le livre.
 Comme dans tous les livres de la collection, les textes sont brefs, deux ou trois pages maximum. Ils ne visent pas à l’exhaustivité, mais provoquent la curiosité, et donnent envie d’aller plus loin – notamment sur Internet pour découvrir des images des lieux abordés.
Comme dans tous les livres de la collection, les textes sont brefs, deux ou trois pages maximum. Ils ne visent pas à l’exhaustivité, mais provoquent la curiosité, et donnent envie d’aller plus loin – notamment sur Internet pour découvrir des images des lieux abordés.
Les cartes (signées Karin Doering-Froger) qui les accompagnent, de la même manière, n’ont pas vocation à être réalistes. Rehaussées de couleurs vives, elles donnent au livre son identité graphique, tout en fixant l’endroit décrit sur un petit bout de monde que l’on s’amusera volontiers à resituer sur une mappemonde classique.
Atlas des terres sauvages percute joliment notre imaginaire, et prouve qu’il y a encore, sur notre bonne vieille Terre saturée d’informations, une possibilité d’explorer l’inexplorable et d’échapper à l’emprise de la globalisation. Un passeport vers l’évasion à utiliser sans restriction, en se laissant dériver dans ses pages au fil de ses envies ou de ses curiosités.
Histoire des lieux de légende

Traduit de l’italien par Renaud Temperini
 Faut-il encore présenter Umberto Eco ? Disparu en 2016, cet écrivain italien fut l’un des plus grands érudits de notre époque. Il devint immensément populaire pour ses romans, pourtant pas forcément abordables, y compris Le Nom de la Rose qui lui valut sa renommée mondiale. Mais son esprit curieux et avide de savoir a également arpenté les terres de la philosophie, de la linguistique, de la sémiotique, de l’esthétique, entre autres domaines.
Faut-il encore présenter Umberto Eco ? Disparu en 2016, cet écrivain italien fut l’un des plus grands érudits de notre époque. Il devint immensément populaire pour ses romans, pourtant pas forcément abordables, y compris Le Nom de la Rose qui lui valut sa renommée mondiale. Mais son esprit curieux et avide de savoir a également arpenté les terres de la philosophie, de la linguistique, de la sémiotique, de l’esthétique, entre autres domaines.
Dans une collection de beaux livres illustrés avec une richesse répondant à l’abondance intellectuelle de l’auteur, les éditions Flammarion ont publié quelques livres qui rencontrèrent eux aussi un grand succès : Histoire de la laideur, Histoire de la beauté, et cette Histoire des lieux de légende dont je souhaite vous dire quelques mots.
C’est avec beaucoup d’humilité que je l’aborde, car se confronter à une intelligence aussi puissante que celle d’Umberto Eco est profondément intimidant. Mais également stimulant, car dès lors que l’on se lance, on peut être sûr d’apprendre énormément de choses, et d’ouvrir d’innombrables portes de curiosité qu’une seule vie ne suffirait pas à explorer. Ce pourrait être frustrant (ça l’est, parfois), mais c’est avant tout excitant.

George Arnald, Ruines de l’abbaye de Glastonbury
Dans cet ouvrage, plus accessible que d’autres de ses livres, Umberto Eco part donc en quête de lieux mythiques qui, depuis des siècles, fascine les écrivains, les poètes, les penseurs, les historiens, mais aussi les explorateurs de l’impossible. Et, bien sûr, les lecteurs qui, grâce aux œuvres inspirées par ces lieux, en ont abordé les rivages et arpenté les fabuleux décors.
L’Eldorado, l’Atlantide, Thulé, le Pays de Cocagne figurent parmi ces destinations extraordinaires, tout comme les territoires de la Bible, ceux croisés par Homère durant son Odyssée, ou ceux qui furent le théâtre des aventures du Graal.
Mais Umberto Eco s’intéresse également à des lieux réels, transfigurés par une page d’Histoire assortie de pas mal de fantasmes et d’imagination, comme Rennes-le-Château et son abbé Saunière.
Ou encore ce qu’il appelle les lieux de la vérité romanesque : des lieux créés par des romanciers, dont on sait qu’ils n’existent pas mais auxquels la littérature nous permet de croire sans réserve – ainsi du Poudlard de Harry Potter, du château de Dracula en Transylvanie ou du 221B Baker Street, célèbre adresse où réside Sherlock Holmes, alors même qu’il n’y a pas de numéro 221B dans la véritable Baker Street de Londres.
 Chaque chapitre est éclairé d’œuvres picturales représentant les lieux évoqués, ainsi que d’extraits d’œuvres littérales qui en font la description. De quoi, là encore, donner envie d’aller voir plus loin, et de poursuivre sans limite les explorations dont Umberto Eco se fait le guide avec érudition mais simplicité, et une gourmandise intellectuelle qui incite sans réserve à partager sa table.
Chaque chapitre est éclairé d’œuvres picturales représentant les lieux évoqués, ainsi que d’extraits d’œuvres littérales qui en font la description. De quoi, là encore, donner envie d’aller voir plus loin, et de poursuivre sans limite les explorations dont Umberto Eco se fait le guide avec érudition mais simplicité, et une gourmandise intellectuelle qui incite sans réserve à partager sa table.
COUP DE CŒUR : Les frères Lehman, de Stefano Massini

Les amis, lâchez tout, attachez vos ceintures et ouvrez grand les écoutilles, aujourd’hui je vais vous parler de la dinguerie absolue de la rentrée. Il en faut au moins une – l’année dernière c’était Jérusalem d’Alan Moore, cette année voici venir Les frères Lehman de Stefano Massini. 848 pages d’inventivité, d’intelligence et de virtuosité littéraire, c’est si rare que ça ne se refuse pas.
 De quoi est-il question ?
De quoi est-il question ?
Hé bien, d’économie, de la crise des subprimes aux États-Unis en 2008…
NOOOOOON, ne partez pas !!!
Ce n’est qu’un aspect de ce livre. Un aspect incontournable, forcément, mais qui n’en est que le grand final.
En réalité, comme le titre l’indique de manière transparente, Stefano Massini s’attache à nous raconter l’histoire des frères Lehman, plus connus dans le monde aujourd’hui, y compris en France, sous le nom des Lehman Brothers. Rien à voir avec la tribu d’humoristes moustachus ayant fait les beaux jours du cinéma au XXème siècle, ni avec le duo mythique de chanteurs fictionnels ayant eux aussi connu leur heure de gloire sur grand écran en 1980.
Non, les Lehman Brothers, ce n’est pas le même genre d’humour, on va dire.
Tout commence en 1844. Un Juif allemand nommé Hayum Lehmann débarque à New York. En passant à la douane, pour mieux se faire comprendre et s’intégrer, il change son nom en Henry Lehman. Il gagne ensuite Montgomery, en Alabama, où il fonde une sorte d’épicerie générale. Un magasin minuscule, qu’il va agrandir peu à peu et transformer en entreprise florissante avec l’aide de ses frères Emanuel et Mayer, qui le rejoignent quelque temps plus tard.
Ils se spécialisent notamment dans le marché du coton, anticipent les grands changements de la vie américaine suivant le développement des chemins de fer, passent miraculeusement au travers de la Guerre de Sécession, et deviennent peu à peu un énorme établissement de conseil coté en Bourse, puis une banque qui affronte avec vaillance les soubresauts de l’Histoire – jusqu’à son effondrement spectaculaire en 2008, victime d’un système qui a perdu la tête et qu’elle a contribué à décapiter.
De 1844 à aujourd’hui, la vie des frères Lehman et de leurs successeurs est donc inextricablement liée à celle des États-Unis. C’est ce que le livre monumental de Stefano Massini nous raconte, et c’est déjà extrêmement intéressant en soi.
Mais ce qui fait des Frères Lehman un ouvrage exceptionnel, un roman hors du commun (car c’est un roman, pas un essai historique), c’est sa forme insensée. En effet, pour donner au récit le souffle épique qu’il mérite, pour en faire une odyssée des temps modernes, Massini a choisi d’écrire en vers libres. Pas de rimes, mais de fréquents retours à la ligne, des phrases courtes, la quête obsessionnelle d’un rythme atypique et marquant, appuyée par un jeu savant sur les répétitions, la litanie, la scansion.
C’est un travail ahurissant, homérique (comme il se doit quand on écrit une odyssée). Et le résultat est fabuleux. On engloutit les 848 pages du livre (qui contient d’autres surprises étonnantes) sans même s’en rendre compte. On se passionne pour ces vies hors du commun, leurs joies, leurs amours, leurs chagrins, leurs inventions, leur aplomb pour affronter l’Histoire et lui trouver des réponses héroïques quand elle s’emballe sous leurs yeux.
Pour ceux que la forme simili-poétique pourrait rebuter, ne craignez rien. C’est un atout plutôt qu’un frein. Je ne suis pas lecteur de poésie en général, c’est un genre dans lequel je peine à investir le temps et la concentration nécessaires pour l’apprécier. Mais là, c’est autre chose. Ce choix audacieux, transfiguré par la traduction sublime de Nathalie Bauer (dont il faut saluer le travail, ça n’a pas dû être simple tous les jours !), devient une tempête qui abat toutes les réticences sur son passage. Dès les premières lignes, on est emporté par le texte, sa fougue, son indiscipline, son humour aussi, et par la force inédite de ses images.
Les frères Lehman est un livre aussi rare que captivant, une somme de documentation, de réflexion et de mise en perspective historique métamorphosée en récit grandiose. Le texte le plus ambitieux de l’année, sans aucun doute. Une expérience de lecture inouïe que je vous recommande sans aucune restriction.
Les frères Lehman, de Stefano Massini
(Qualcosa sui Lehman, traduit de l’italien par Nathalie Bauer)
Éditions Globe, 2018
ISBN 978-2-211-23513-6
848 p., 24€
COUP DE COEUR : La Note américaine, de David Grann

Au début des années 1920, aux États-Unis, la plupart des Indiens ayant survécu aux exterminations méthodiques des colons sont parqués dans des réserves. Tous, à vrai dire, sauf ceux de la tribu Osage. Après avoir été repoussé de leurs territoires d’origine au fil des années, ils ont fini par accepter l’offre de terres arides et minérales au fin fond de l’Oklahoma. Un cadeau à double tranchant pour ceux qui ont condescendu à leur faire ce présent qu’ils pensaient misérable : le sous-sol s’est révélé extraordinairement riche en pétrole, assurant la fortune des Osages qui en avaient la propriété exclusive.
Une telle situation ne pouvait évidemment pas plaire à tout le monde.
Un jour, deux membres de la tribu disparaissent. On retrouve la femme abattue d’une balle dans la tête. S’ensuivent des empoisonnements, l’explosion d’une maison, d’autres disparitions, d’autres meurtres. La terreur s’empare des Osages, ces Indiens qui vivent comme des colons – voire mieux que la plupart d’entre eux, puisqu’ils ont même des domestiques blancs… Un affront insoutenable pour certains. Les premières enquêtes sont bâclées, à tel point que le gouvernement fédéral se voit obligé d’intervenir. Un jeune homme de 29 ans, à la tête du BOI (Bureau Of Investigation), est chargé des investigations. Il s’appelle J. Edgar Hoover, il est assoiffé de pouvoir, et voit dans cette terrible enquête l’occasion de parvenir à ses fins.
Tout est en place pour l’un de ces grands drames qui nourrissent la terre américaine de sang et de violence.
 C’est cette histoire ahurissante que David Grann, journaliste au New Yorker, narre ici par le détail. Et le résultat est exceptionnel à tous les titres. La Note américaine est avant tout d’une rigueur et d’une richesse documentaire formidables. Fouillant dans toutes les archives disponibles, suivant sur le terrain la piste des descendants des victimes comme des coupables, Grann s’attache à dresser le tableau le plus complet possible, et y parvient d’une manière magistrale. Même sans être familier avec l’Histoire américaine, on comprend tout, on saisit tout, et on apprend énormément de choses, en commençant par le parcours singulier de la tribu Osage qu’il faut bien maîtriser pour capter la suite de l’affaire.
C’est cette histoire ahurissante que David Grann, journaliste au New Yorker, narre ici par le détail. Et le résultat est exceptionnel à tous les titres. La Note américaine est avant tout d’une rigueur et d’une richesse documentaire formidables. Fouillant dans toutes les archives disponibles, suivant sur le terrain la piste des descendants des victimes comme des coupables, Grann s’attache à dresser le tableau le plus complet possible, et y parvient d’une manière magistrale. Même sans être familier avec l’Histoire américaine, on comprend tout, on saisit tout, et on apprend énormément de choses, en commençant par le parcours singulier de la tribu Osage qu’il faut bien maîtriser pour capter la suite de l’affaire.
David Grann du reste ne s’en tient pas à la seule restitution du drame, il va plus loin en intervenant dans le récit, pour ouvrir de nouvelles portes, élargir les perspectives de son histoire, et interroger la nature même de son pays, dont il est toujours utile de rappeler que ses racines baignent abondamment dans le sang.
La Note américaine est aussi un livre captivant – pour reprendre un cliché vieux comme le crime, il se dévore comme le meilleur des polars. Sauf que tout est vrai, bien entendu. Ce qui rend le récit encore plus fort, plus glaçant ; ce qui permet à David Grann de toucher au plus juste et au plus profond des âmes, que ce soit pour restituer la terreur des victimes ou l’horrifiante noirceur des meurtriers ou de leurs commanditaires. Le journaliste maîtrise l’art du romancier pour mener son histoire à un rythme implacable qui brise toute tentation de lâcher prise. J’insiste sur ce point, car la nature seule du récit suffit à justifier de s’y plonger ; mais la virtuosité littéraire mise en œuvre par Grann, restituée par la traduction puissante de Cyril Gay, participe largement de l’enthousiasme qui naît au fil des pages.
On peut comprendre que la parution l’année dernière aux États-Unis de la Note américaine ait secoué l’opinion publique outre-Atlantique. Ils n’ont d’ailleurs pas fini d’en entendre parler, car Martin Scorsese s’est emparé du livre et travaille en ce moment même à son adaptation sur grand écran. Un signe, parmi d’autres, de l’importance du travail de David Grann, que je vous invite ardemment à découvrir, tout en remerciant les éditions Globe de nous en avoir offert aussi vite la lecture.
La Note américaine, de David Grann
(Killers of the Flower Moon, traduit de l’américain par Cyril Gay)
Éditions Globe, 2018
ISBN 978-2-211-23289-0
366 p., 22€
Laëtitia ou la fin des hommes d’Ivan Jablonka
 S’il y a bien un livre terrifiant en cette rentrée littéraire, c’est celui-là. Tout le monde se souvient du meurtre de la jeune Laëtitia Perrais, 18 ans, au début de l’année 2011. On se souvient de l’horreur de sa mort, de l’emballement médiatique qui a suivi, du président de la République hystérique qui provoqua un séisme dans le monde pourtant si discret de la magistrature. On n’oublie pas l’abomination quand, quelques temps après sa mort, on apprend que Laëtitia était régulièrement violée par l’homme chez qui elle et sa sœur avaient été placées par l’Assistance Publique. En 18 ans de vie, Laëtitia Perrais n’a vécu que dans l’horreur, la douleur, l’angoisse, la peur. Pour mourir de la même façon. Dans l’horreur, la douleur, l’angoisse et la peur.
S’il y a bien un livre terrifiant en cette rentrée littéraire, c’est celui-là. Tout le monde se souvient du meurtre de la jeune Laëtitia Perrais, 18 ans, au début de l’année 2011. On se souvient de l’horreur de sa mort, de l’emballement médiatique qui a suivi, du président de la République hystérique qui provoqua un séisme dans le monde pourtant si discret de la magistrature. On n’oublie pas l’abomination quand, quelques temps après sa mort, on apprend que Laëtitia était régulièrement violée par l’homme chez qui elle et sa sœur avaient été placées par l’Assistance Publique. En 18 ans de vie, Laëtitia Perrais n’a vécu que dans l’horreur, la douleur, l’angoisse, la peur. Pour mourir de la même façon. Dans l’horreur, la douleur, l’angoisse et la peur.
Ivan Jablonka, professeur d’université, a toujours été écrit sur les enfants perdus. Il a signé plusieurs ouvrages sur les enfants de l’Assistance Publique, mais aussi un ouvrage formidable que j’avais lu avec beaucoup d’intérêt, Histoire des grands-parents que je n’ai pas eus, sur ses aïeux disparus à Auschwitz. L’auteur se fait la voix des enfants abandonnés, des laissés-pour-compte de la société, des destinées tragiques. La trajectoire de la comète Laëtitia, qui recoupe tous ces thèmes, était faite pour rencontrer Jablonka.
A la fois polar, essai sociologique et documentaire, Laëtitia ou la fin des hommes part d’un sordide fait divers. Jablonka suit les procès, rencontre ceux qui ont côtoyé la jeune fille et cherche à savoir qui elle était, ce qu’elle aimait et comment sa vie a été un drame permanent. Cet ouvrage retrace une vie cabossée et l’auteur rend à la victime toute la dignité qui lui a été ôtée au fil des années. Ce livre m’a serré plusieurs fois le cœur car les mots sont durs, parfois crus. Mais il fallait en passer par là pour voir en face toute la violence faite aux femmes, verbale, physique, morale.
Je me demande si la sœur jumelle de Laëtitia et sa famille ont lu cette plongée au cœur de la misère et ce qu’ils en ont pensé. S’ils se sont reconnus. S’ils ont apprécié l’hommage rendu à cette jeune fille perdue dans ce livre-choc. Un livre qui aurait pu aussi s’intituler Laëtitia ou la folie des hommes…
Laëtitia ou la fin des hommes d’Ivan Jablonka
Éditions du Seuil, 2016
9782021291223
400 p., 21€
Un article de Clarice Darling.
COUP DE COEUR : 14 juillet, d’Eric Vuillard
Signé Bookfalo Kill
Même les plus quiches en histoire savent de quoi on parle lorsqu’on évoque la date du 14 juillet. Événement fondateur de notre histoire contemporaine, pierre angulaire de la Révolution Française, la prise de la Bastille est connue de tous, et même toi, oui toi qui pionçais au fond de la classe contre le radiateur, quand on te dit « 14 juillet », tu penses… oui, bon, d’abord « jour férié ». Mais ensuite tu es capable de te rappeler le discours de Camille Desmoulins qui contribue à enflammer Paris, le peuple en armes massé au pied de la forteresse pour réclamer de la poudre, le siège furieux, la prise éclair de la forteresse, la libération de ses sept pauvres prisonniers (au lieu des dizaines fantasmés), le massacre du gouverneur de Launay dont la tête a été promenée sur une pique dans toute la ville…
 Comment dès lors proposer un récit original de cette fameuse journée ? Il fallait qu’il y ait une idée neuve dans le projet, et pour cela, on peut faire confiance à Eric Vuillard, dont la spécialité consiste justement à s’emparer d’un fait historique pour en tirer une matière littéraire fulgurante d’intelligence – voir le superbe Tristesse de la terre sur Buffalo Bill, par exemple.
Comment dès lors proposer un récit original de cette fameuse journée ? Il fallait qu’il y ait une idée neuve dans le projet, et pour cela, on peut faire confiance à Eric Vuillard, dont la spécialité consiste justement à s’emparer d’un fait historique pour en tirer une matière littéraire fulgurante d’intelligence – voir le superbe Tristesse de la terre sur Buffalo Bill, par exemple.
Dans son 14 juillet, le projet de Vuillard est tout simplement de délaisser les manuels d’histoire, l’iconographie usuelle, et de raconter l’événement en se glissant dans la foule. Célébrer les anonymes, nommer et citer les gens du peuple qui ont fait tomber la Bastille. Gratter sa plume au ras du bitume et en tirer la matière la plus viscérale qui soit. Et il y parvient avec un brio confondant.
Vuillard commence en effet par résumer le contexte politique et économique qui constitua le terreau de la Révolution. Quelques pages, pas plus, mais quelles pages ! Il va à l’essentiel sans faire de raccourcis, et parvient au passage à élaborer une chambre d’échos dans laquelle nos actuels temps troublés se réverbèrent avec une précision assourdissante – faisant par exemple du fameux Necker, si apprécié du peuple, une sorte de Jérôme Kerviel de l’époque, un spéculateur sans limite :
« Et puis, ce fut Necker de nouveau, afin de rassurer la Bourse, car c’est à la Bourse, déjà, qu’on prenait la température du monde. (…) Il avait commencé sa belle carrière chez Girardot, une banque d’affaires franco-suisse (…) Il ne se tint pas aux directives qu’on lui avait laissées et prit une position hasardeuse – comme ces traders qui, de nos jours, jettent leurs ordres entre les mâchoires du monstre, en espérant que cela passe. Et cela passa. Il réalisa d’un coup un formidable bénéfice de cinq cent mille livres. On le prit aussitôt pour associé. » (p.39)
S’appuyer sur le passé pour mettre en perspective le présent, la démarche n’est pas neuve mais elle reste intéressante, et Vuillard propose plusieurs parallèles qui frappent et font réfléchir. Mais c’est la suite de sa démarche, sa manière d’isoler à tour de rôle les véritables acteurs de la journée, qui étonne le plus. Jamais on n’a raconté le 14 juillet de cette manière, au plus près des gens, au cœur de l’événement. Paris prend forme et vie, grouillante, furieuse, impatiente, joyeuse, incroyablement diverse. La chaleur intense nous écrase, nous prenons avec enthousiasme la moindre arme qui nous tombe sous la main, nous roulons péniblement des canons dont nous ne savons pas nous servir jusqu’à l’énorme forteresse, nous nous rions des députés pathétiques qui tentent de négocier on ne sait quoi pour contenir l’inévitable violence ; nous voyons tomber les morts, nous tentons de sauver les blessés, debout aux côtés de tous ceux dont Vuillard a retrouvé les noms, lisant les relations que certains ont fait de leur implication.
Eric Vuillard n’est pas historien, 14 juillet n’est pas un livre d’histoire. Dans sa démarche, il ajoute la liberté du romancier, ce qui lui permet de dire au début du chapitre « La foule » :
« Il faut écrire ce qu’on ignore. Au fond, le 14 juillet, on ignore ce qui se produisit. Les récits que nous en avons sont empesés ou lacunaires. C’est depuis la foule sans nom qu’il faut envisager les choses. Et l’on doit raconter ce qui n’est pas écrit. Il faut le supputer du nombre, de ce qu’on sait de la taverne et du trimard, des fonds de poche et du patois des choses, liards froissés, croûtons de pain. »
Cette appropriation, il l’accomplit dans une langue d’écrivain virtuose, qui se gargarise d’argot, d’un vocabulaire grouillant et d’expressions à l’emporte-pièce pour créer un style gai, percutant, aussi agité que l’immense foule venue faire tomber la Bastille.
Bref, quel livre ! Inclassable, brillant, inspiré, vivant, ce 14 juillet mériterait d’être inscrit dans les programmes scolaires pour démontrer que l’Histoire, quand elle est abordée avec esprit et liberté, peut toujours être passionnante, même quand elle aborde des sujets apparemment rebattus.
14 juillet, d’Eric Vuillard
Éditions Actes Sud, 2016
ISBN 978-2-330-06651-2
200 p., 19€
Vacher l’éventreur de Régis Descott
Joseph Vacher était un bel homme. L’œil sombre et le regard dur, les sourcils en bataille, la mâchoire carrée. Mais Joseph Vacher était aussi timbré. Un véritable fou qui, au XIXème siècle, tua et dépeça pendant des années bergères et bergers, vieilles femmes et enfants, avant d’être arrêté, jugé, condamné à mort et exécuté.
 De cet homme aussi fascinant qu’effrayant, Régis Descott cherche à faire un personnage de roman, sans en écrire une seule ligne. Comment? En faisant des copiés-collés des articles parus à l’époque, des comptes-rendus d’audience, des rapports d’autopsie et des lettres écrites par l’assassin. Il a passé un temps assez incroyable à collecter les traces laissées par Joseph Vacher pour nous raconter l’histoire de ce vagabond fou.
De cet homme aussi fascinant qu’effrayant, Régis Descott cherche à faire un personnage de roman, sans en écrire une seule ligne. Comment? En faisant des copiés-collés des articles parus à l’époque, des comptes-rendus d’audience, des rapports d’autopsie et des lettres écrites par l’assassin. Il a passé un temps assez incroyable à collecter les traces laissées par Joseph Vacher pour nous raconter l’histoire de ce vagabond fou.
Peut-on dire que recopier des textes trouvés dans les archives est un roman? Ce que l’auteur appelle, dans son introduction, un « roman-vrai ». Très honnêtement, je ne pense pas. Certes, il a ordonné les archives dans un sens qui lui appartient mais sans ajouter la moindre ligne pour nous donner sa vision, son ressenti. Pour moi, cet ouvrage consiste en un agencement d’archives qui, même si elles sont très intéressantes et retracent bien les atrocités commises et la folie du personnage, ne constitue pas un roman.
Mais rien ne sert d’épiloguer plus longtemps là-dessus, si vous souhaitez vous plonger dans des rapports d’autopsie (qui par définition sont parfois assez gores) et découvrir l’un des tous premiers serial killers français, n’hésitez pas, Vacher l’Éventreur se lit d’une traite.
Vacher l’Éventreur de Régis Descott
Éditions Grasset, 2015
9782246809920
274p., 19€
Un article de Clarice Darling.
Rien où poser sa tête, de Françoise Frenkel
Signé Bookfalo Kill
Hasard du calendrier, en fin d’année dernière, alors que Viviane Hamy proposait une nouvelle édition de 33 jours de Léon Werth, Thomas Simonnet, le très inspiré directeur de la collection « L’Arbalète » des éditions Gallimard, publiait un autre témoignage majeur sur les années 40 en France : Rien où poser sa tête, de Françoise Frenkel.
Comme 33 jours, Rien où poser sa tête est en soi une aventure éditoriale incroyable. Écrit en 1943, publié à Genève en 1945, ce livre fut ensuite totalement oublié. Jusqu’à ce qu’un écrivain attentif n’en retrouve un exemplaire dans un fourbi d’Emmaüs à Nice, où Françoise Frenkel mourut en 1975. Le dit écrivain transmit à un ami la pépite, qui finit sur le bureau de Thomas Simonnet, puis entre les mains d’un certain Patrick Modiano qui en signe la préface.
 Pourquoi ce nouvel engouement pour un texte qui avait disparu de la circulation ? Parce qu’il présente un témoignage sur le vif des années d’occupation en France, avec un souci du détail et une précision vraiment rares. L’histoire de Françoise Frenkel, jeune juive polonaise, commence pour ainsi dire en 1921, lorsqu’elle ouvre une librairie à Berlin, avec le désir naïf de défendre la littérature française dans un pays humilié par les conditions drastiques du Traité de Versailles. Surmontant l’hostilité initiale des Allemands, elle parvient à imposer ses choix, jusqu’à ce que l’avènement d’Hitler ne la confronte à d’autres formes de haine plus radicales.
Pourquoi ce nouvel engouement pour un texte qui avait disparu de la circulation ? Parce qu’il présente un témoignage sur le vif des années d’occupation en France, avec un souci du détail et une précision vraiment rares. L’histoire de Françoise Frenkel, jeune juive polonaise, commence pour ainsi dire en 1921, lorsqu’elle ouvre une librairie à Berlin, avec le désir naïf de défendre la littérature française dans un pays humilié par les conditions drastiques du Traité de Versailles. Surmontant l’hostilité initiale des Allemands, elle parvient à imposer ses choix, jusqu’à ce que l’avènement d’Hitler ne la confronte à d’autres formes de haine plus radicales.
Elle résiste jusqu’à la fin des années 30, avant d’admettre qu’elle est en danger, de renoncer à défendre sa librairie agonisante et de se réfugier en France. Elle vit à Paris lorsque les Allemands écrasent leur vieil ennemi héréditaire le temps d’une guerre éclair impitoyable, et décide, comme beaucoup de Français, de partir vers le sud. Commence alors une longue errance, qui voit Françoise Frenkel se poser à Avignon, repartir à Vichy où vient de s’établir le nouveau gouvernement français, puis descendre jusqu’à Nice, avant de concevoir en dernier recours, menacée par son statut de juive, une fuite vers la Suisse…
J’ai résumé ici, volontairement, les nombreuses péripéties que narre Françoise Frenkel dans Rien où poser sa tête (superbe titre au passage, qui dit si bien la grande précarité de l’individu en fuite permanente). En soi, ces aventures sont déjà passionnantes et méritent d’être lues en intégralité, d’autant qu’elles sont racontées avec une élégance littéraire confondante, surtout pour un texte rédigé rapidement, qui s’acharne néanmoins à retranscrire avec la plus grande des précisions le moindre détail, le moindre décor, chaque vêtement, chaque visage croisé. Car c’est bien ceci qui rend Rien où poser sa tête si précieux : pour ma part, j’ai rarement lu un livre capable de plonger son lecteur avec autant de réalisme dans cette époque pourtant si souvent représentée, que ce soit dans des romans, des essais, des films ou des séries.
Ce qui est encore plus extraordinaire, c’est le ton de Françoise Frenkel dans cet ouvrage. Je l’ai mentionné, c’est un livre formidablement bien écrit. L’auteure ne se contente pas de raconter son parcours, elle le fait avec beaucoup de verve, qui trahit un caractère bien trempé, celui d’une femme forte, audacieuse même par moment en dépit de la peur légitime qui la pousse à fuir bien souvent. Une femme portée sur l’espoir, soulignant les nombreux efforts de gens prenant des risques énormes pour la protéger, la cacher, l’aider à avancer – mais ne cachant rien non plus des bassesses et des mesquineries d’autres personnes, prêtes à exploiter sa situation de faiblesse, voire à la dénoncer pour garantir leur maigre tranquillité.
Il serait sûrement risqué de tout prendre pour argent comptant dans Rien où poser sa tête, qu’il convient de considérer plus comme un témoignage littéraire que comme un document historique. Mais c’est véritablement un texte d’une force, d’une intelligence et d’une sensibilité remarquables, autant qu’un regard passionnant sur une époque complexe. Un livre, n’ayons pas peur des mots, indispensable.
Rien où poser sa tête, de Françoise Frenkel
Éditions Gallimard, coll. l’Arbalète, 2015
ISBN 978-2-07-010839-8
290 p., 16,90€
Pourquoi je n’ai pas dépassé la page 50 : L’Imposteur, de Javier Cercas
Pourquoi choisit-on un livre ? Et surtout, pourquoi en abandonne-t-on la lecture au bout de quelques pages ? C’est le but de cette rubrique que d’expliquer un choix aussi radical, qui ne laisse pas toute sa chance à un auteur et risque de faire passer le lecteur à côté d’un roman peut-être extraordinaire au-delà de la page 50…
Bien évidemment, n’ayant pas lu le livre en entier, il s’agit moins d’en faire une critique que de parler d’une expérience défavorable de lecteur. Nous nous efforcerons donc d’être aussi mesurés que possible, sans rien cacher non plus de notre sévérité, de notre agacement ou de notre déception. Un exercice difficile mais, espérons-le, instructif et intéressant !
*****
En fait de page 50, j’ai achevé ma lecture à la page 128. Pourquoi? Comment?
 L’imposteur de Javier Cercas avait tout pour me plaire. La guerre, l’histoire et surtout, un mensonge énorme.
L’imposteur de Javier Cercas avait tout pour me plaire. La guerre, l’histoire et surtout, un mensonge énorme.
Enric Marco est né en 1921 en Espagne, anti-franquiste durant la Guerre d’Espagne, il s’engage ensuite pendant la Seconde Guerre Mondiale et est déporté au camp de Mauthausen. A son retour, il devient un syndicaliste virulent et une icône nationale pour toute une génération d’Espagnols, un héros de la nation.
Sauf que tout ça, c’est du flan. Il a été démontré que Marco n’a probablement jamais combattu pendant la guerre de 1936 et qu’il était un des travailleurs volontaires pour se rendre en Allemagne, afin de se constituer un petit pécule et revenir riche dans son pays. Il a effectivement été un dirigeant de syndicat, dont il a été éjecté.
En 2005, son secret est découvert par un journaliste. Tout n’est que mensonge.
Javier Cercas nous livre ici un ouvrage assez complexe, entre essai historique, interrogation permanente sur le métier d’écrivain et livre de psychologie sur le mensonge. C’est très difficile de se situer par rapport à tout ça.
J’ai été déçue par le style – attention, je vous rappelle que je n’ai lu que 128 pages sur un livre qui en fait 416 – que j’ai trouvé assez lourd (beaucoup de répétitions, notamment plusieurs pages où chaque phrase débute par « Il dit que »). Peut-être qu’ensuite, cela s’améliore, je ne sais pas.
Pour pouvoir lire et comprendre l’ouvrage, il faut bien s’y connaître en histoire, notamment connaître sur le bout des doigts la chronologie de la Guerre d’Espagne. N’y connaissant rien, j’ai été vite noyée par les lieux, les dates, les noms des personnes citées. Aucun renvoi, aucune note de bas de page pour aider le lecteur novice dans sa compréhension.
Enfin, des quelques pages que j’ai lues, je ne retiens pas grand-chose. Javier Cercas est certes obnubilé sur le fait qu’Enric Marco ait menti tout ce temps à tout le monde, même à sa famille, mais on ne sait pas ce qu’il pense au fond de lui même. Peut-être le sait-on à la fin du livre? L’auteur nous explique sa démarche, son procédé d’écriture mais dévoile très peu ses sentiments à propos de son « personnage », pour ne pas fausser le résultat peut-être? A voir sur les 288 pages restantes.
J’ai préféré arrêter ma lecture car je me noyais dans les eaux de la Bidassoa, entre les lignes de Javier Cercas, et j’ai capitulé. Cannibales à peine entamés, cannibales déjà lassés.
L’imposteur, de Javier Cercas
Éditions Actes Sud, 2015
9782330053079
416p., 23€50
Un article de Clarice Darling.
Le bercail, de Marie Causse
 Esther est une petite jeune femme qui, pour se payer ses études, fait des ménages chez les personnes âgées de son patelin, au fin fond du Massif Central. En même temps qu’elle astique la cuisinière ou fait les poussières, elle les fait parler de la guerre, sa curiosité sur ce sujet étant sans limite.
Esther est une petite jeune femme qui, pour se payer ses études, fait des ménages chez les personnes âgées de son patelin, au fin fond du Massif Central. En même temps qu’elle astique la cuisinière ou fait les poussières, elle les fait parler de la guerre, sa curiosité sur ce sujet étant sans limite.
Un jour, on enterre la Marthe, une dame centenaire, renfermée sur elle-même, chez qui Esther n’est jamais allée. Elle sait juste qu’une rumeur circule dans le village, concernant Odette, la fille de Marthe et Alphonse, frère aîné du grand-père d’Esther. Que s’est-il passé en 1944? Pourquoi Alphonse a été fusillé? Odette, amoureuse éconduite, aurait-elle dénoncé celui pour qui elle soupirait?
Mais dans le village, c’est le mur du silence qui s’abat sur cette histoire. D’autant qu’Odette débarque et s’installe dans la maison de feue sa mère…
Marie Causse a une plume que j’ai découvert avec délectation. C’est beau, bien écrit, on sent les études littéraires chez cette brillante auteure. Si l’histoire d’Esther et de son village est symptomatique des années d’après-guerre, je dois vous avouer ma préférence pour la seconde partie du livre. Cette fois, plus de mise en scène, plus de mensonge, plus de roman. Esther redevient Marie, l’auteure, et cette dernière nous raconte l’histoire de sa famille. Elle part en quête, dans les archives et auprès des derniers anciens, de l’histoire de son arrière-grand-père, arrêté par un Français et mort en déportation, dénoncé pour avoir une cache d’armes dans un cabanon au fond d’un de ses champs. Mais… et si c’était pour couvrir son fils unique, François, que l’arrière-grand-père de Marie s’était constitué prisonnier?
Pour honorer sa mémoire et aider sa grand-mère à comprendre pourquoi son père avait été tué, Marie Causse va enquêter pendant plusieurs mois et nous fait revivre, dans cette deuxième partie, la traque à l’indice, aux infos, les journées aux archives.
C’est beau, émouvant, triste et fort à la fois. Marie Causse a cette force de l’écriture, cette beauté des intentions qui font de son livre, non pas un énième récit sur la guerre, mais un hymne d’amour à ses ancêtres, morts ou vivants.
Le bercail, de Marie Causse
Collection l’Arpenteur
Éditions Gallimard, 2015
9782070106578
239 p., 19€90
Un article de Clarice Darling.
Et tu n’es pas revenu de Marceline Loridan-Ivens
 Cela fait cinq minutes que j’ai refermé l’ouvrage. Mais il m’a fallu une éternité pour le finir. Je ne voulais pas que cela cesse. Je voulais que Marceline Loridan-Ivens reste encore un peu avec moi, pour me parler, m’expliquer les mille vies qu’elle a vécues.
Cela fait cinq minutes que j’ai refermé l’ouvrage. Mais il m’a fallu une éternité pour le finir. Je ne voulais pas que cela cesse. Je voulais que Marceline Loridan-Ivens reste encore un peu avec moi, pour me parler, m’expliquer les mille vies qu’elle a vécues.
Il m’est impossible de vous faire une critique de Et tu n’es pas revenu, co-écrit avec Judith Perrignon. Comment le pourrais-je?
Cet ouvrage, c’est un cri du cœur, le cri d’une petite fille de 15 ans. Une ado qui cherche à fuir avec son père, la Gestapo venue les arrêter. La course effrénée dans le jardin et la clôture infranchissable. Puis la prison, le transport, la déportation et, pour son père, la mort.
« Toi, tu reviendras peut-être parce que tu es jeune, moi je ne reviendrai pas. » Cette phrase prononcée par son père à Drancy, elle décide de la prendre comme une prophétie. Elle est revenue, pas lui. Et tu n’es pas revenu décrit l’absence, le gouffre, le traumatisme. C’est une lettre d’une fille à son père disparu, elle-même à l’aube de sa propre mort.
Ma gorge en est encore nouée. Cela fait 15 minutes que le livre est refermé. Pour sûr qu’il restera longtemps, très longtemps, dans mes pensées.
Et tu n’es pas revenu de Marceline Loridan-Ivens
Éditions Grasset, 2015
9782246853916
107p., 12€90
Un article de Clarice Darling.
Les inoubliables de Jean-Marc Parisis
 Sur le papier, ce livre était fait pour moi. Comment, en partant d’une photographie d’enfants, on remonte les affres de la mémoire pour arriver à la Bachellerie, petit village de Dordogne, pendant la Seconde Guerre Mondiale ? Ces cinq enfants, nés juifs, furent tous déportés avec leur famille, leurs voisins, leurs copains, juifs ou maquisards. L’auteur connaît bien ce village pour y avoir passé toutes ses vacances de jeunesse chez ses grands-parents. Mais il ne savait quasiment rien des horreurs perpétrées autrefois. Et cet ouvrage avait tout l’air d’une quête, que ce soit sur les traces de ces enfants disparus ou celle de l’auteur, à la recherche de survivants.
Sur le papier, ce livre était fait pour moi. Comment, en partant d’une photographie d’enfants, on remonte les affres de la mémoire pour arriver à la Bachellerie, petit village de Dordogne, pendant la Seconde Guerre Mondiale ? Ces cinq enfants, nés juifs, furent tous déportés avec leur famille, leurs voisins, leurs copains, juifs ou maquisards. L’auteur connaît bien ce village pour y avoir passé toutes ses vacances de jeunesse chez ses grands-parents. Mais il ne savait quasiment rien des horreurs perpétrées autrefois. Et cet ouvrage avait tout l’air d’une quête, que ce soit sur les traces de ces enfants disparus ou celle de l’auteur, à la recherche de survivants.
Jean-Marc Parisis s’en est tenu aux faits et n’a pas cherché à romancer quoi que ce soit. Les historiens pure souche l’en remercieront mais pour les amateurs de littérature, c’est un peu aride. J’aurais aimé m’attacher un peu plus aux personnes citées dans le texte. Avoir peur avec les enfants Schenkel, vibrer avec Benjamin Schupack, le survivant, sur les traces des tueries de la Bachellerie, haïr Adolphe Denoix le chef de la milice mais je suis restée quasiment insensible. Peut-être la faute au style littéraire, très journalistique, qui n’invoque pas les émotions du lecteur.
J’admire le travail de recherches fait par l’auteur. On ressent le temps de travail, la passion qui l’emporte souvent, le besoin de témoigner pour retrouver ce passé perdu pour rendre cette histoire inoubliable. Mais j’ai refermé le livre avec une impression de brouillon. Peu de descriptions, trop de personnes. J’avais la sensation parfois de lire de pures archives. Je m’attendais à ce que l’auteur s’implique un peu plus, nous livre davantage ses sentiments, à la manière de Daniel Mendelsohn dans Les Disparus.
Les inoubliables de Jean-Marc Parisis
éditions Flammarion, 2014
9782081274075
225p., 18€
Un article de Clarice Darling.
Histoire des grands-parents que je n’ai pas eus d’Ivan Jablonka
 En février 1943, Idesa et Matès Jablonka ont pressenti quelque chose. Depuis plusieurs nuits, ils emmenaient leurs enfants, Suzanne, 4 ans, et Marcel, 3 ans, dormir chez leur voisin, un Polonais non juif.
En février 1943, Idesa et Matès Jablonka ont pressenti quelque chose. Depuis plusieurs nuits, ils emmenaient leurs enfants, Suzanne, 4 ans, et Marcel, 3 ans, dormir chez leur voisin, un Polonais non juif.
Le 25 février 1943, ils ont été raflés à l’aube et déportés quelques jours plus tard vers Auschwitz. Ils n’en sont jamais revenus.
Aujourd’hui, Ivan Jablonka, leur petit-fils, retrace la vie de ses grands-parents qu’il n’a jamais connu. Il mène une véritable enquête pour tenter de comprendre qui étaient ses deux ancêtres. Ils ont fait de la prison dans leurs jeunes années en Pologne pour propagande communiste, ils ont fuit un pays qui les rejetait et traversé une Allemagne qui leur déclarait la guerre. Ils sont arrivés à Paris, quand le reste de la famille s’est sauvée en Amérique Latine ou en URSS.
Ivan Jablonka suit les traces de ses grands-parents, de Parczew à l’est de la Pologne à Paris, de la prison de Lublin au camp de Drancy, de Belleville à Auschwitz, en mars 1943.
Enquête digne d’un polar, ouvrage d’historien, œuvre d’un écrivain, je n’ai pas de terme pour déterminer ce formidable ouvrage qui vous entraîne dans la course folle d’une Europe qui perd la tête.
A la façon de Modiano dans Dora Bruder, Jablonka réalise une enquête minutieuse et nous fait part de ses recherches, avec toujours de la distance entre lui et son sujet. De la pudeur peut-être, la rigueur d’historien sûrement. Jusqu’à l’instant crucial, les deux dernières preuves de vie de ses grands-parents, les lettres jetées depuis le camp de Drancy et que des passants ont eu la gentillesse d’adresser à leur destinataire. Deux courtes lettres-testament où on lit tout le désespoir du monde.
Un livre captivant qui remue la mémoire pour ne pas oublier.
Histoire des grands-parents que je n’ai pas eus d’Ivan Jablonka
Editions du Seuil, 2012 (En poche en 2013)
9782757836699
376p., 9€50
Un article de Clarice Darling.
Sur la scène intérieure, de Marcel Cohen
Impossible de savoir dans quelle catégorie ranger cet ouvrage. Il ne s’agit ni d’un roman, ni d’une biographie. Je l’ai classé dans la catégorie « histoire », en espérant ne pas froisser l’auteur.
 Marcel Cohen a 5 ans et demi en 1943 lorsqu’il voit sa famille se faire emporter dans une rafle. Il doit la vie sauve au simple fait qu’il était au parc avec l’employée de maison. Mais il gardera gravé à jamais dans sa mémoire le départ de ses parents, de sa petite soeur de 3 mois, de ses grand-parents et de son oncle dans la camionnette. D’eux, il ne lui reste plus que des images, quelques objets qui ont survécu soixante-dix ans, et des souvenirs, que ce soient les siens ou d’autres souvenirs, arrachés à la mémoire d’oncles et de tantes, témoins silencieux d’une époque sombre.
Marcel Cohen a 5 ans et demi en 1943 lorsqu’il voit sa famille se faire emporter dans une rafle. Il doit la vie sauve au simple fait qu’il était au parc avec l’employée de maison. Mais il gardera gravé à jamais dans sa mémoire le départ de ses parents, de sa petite soeur de 3 mois, de ses grand-parents et de son oncle dans la camionnette. D’eux, il ne lui reste plus que des images, quelques objets qui ont survécu soixante-dix ans, et des souvenirs, que ce soient les siens ou d’autres souvenirs, arrachés à la mémoire d’oncles et de tantes, témoins silencieux d’une époque sombre.
Ce livre présente ce que Marcel Cohen a pu apprendre. Peu à peu, ses parents reprennent vie, toute sa famille est là, sous nos yeux. Cette famille dont il a été privée par l’horreur de la nature humaine. Il tente de reconstituer avec une précision d’orfèvre, les odeurs, les parfums, les repas, les rires et les angoisses. Il nous livre tout ce qu’il sait de ses proches. Et c’est dérangeant de se dire qu’on en sait autant que lui. Il n’appelle ses parents que par leurs prénoms, peut-être pour marquer une distance avec des gens qu’il a très peu connus ou pour se distinguer d’eux pour ne pas sombrer dans la tristesse.
Jamais l’auteur ne s’apitoie sur son sort. Il relate ces événements, son histoire, avec une froideur relative. Il est écrivain avant d’être fils ou petit-fils. J’admire son écriture. Cette volonté de ne pas céder à la facilité du pathos. C’est un ouvrage poignant et très important pour les générations futures. Pour garder en mémoire les défunts de la Shoah, pour expliquer l’horreur de l’Holocauste et que, pour rien au monde, cela ne recommence.
Sur la scène intérieure de Marcel Cohen
Editions Gallimard, 2013
9782070139293
149p., 17€90
Un article de Clarice Darling
Paysages de la Métropole de la Mort d’Otto Dov Kulka
 Otto Dov Kulka est un rescapé des camps de concentration. Pendant des années, il s’est enregistré sur des cassettes audio. Il racontait ainsi ses souvenirs. Quelques photos sont présentes dans le livre et participe du témoignage de l’horreur qu’à subi Kulka enfant. Dit comme ça, ça semble intéressant, accessible à tous. Détrompez-vous.
Otto Dov Kulka est un rescapé des camps de concentration. Pendant des années, il s’est enregistré sur des cassettes audio. Il racontait ainsi ses souvenirs. Quelques photos sont présentes dans le livre et participe du témoignage de l’horreur qu’à subi Kulka enfant. Dit comme ça, ça semble intéressant, accessible à tous. Détrompez-vous.
La première partie de l’ouvrage est intéressante, il y évoque ses souvenirs, son voyage vers Auschwitz, des années après son passage dans les camps de la mort. Il évoque les personnes qu’il y a rencontrées, les faisant en quelque sorte revivre l’espace de quelques lignes, entrecoupe ses souvenirs de dessins d’enfants qui ne sont jamais revenus des camps. Il parle de sa mère, de son père, de la survie quotidienne. Et puis, à partir de la page 137… il part dans des récits de rêves, des extraits de journaux, des réflexions assez tordues et il faut être bien concentré pour comprendre. J’ai vraiment décroché avec cette deuxième partie qui se veut historico-philosophico-réaliste et qui m’a assommée.
Dommage!
Paysages de la Métropole de la Mort d’Otto Dov Kulka
Editions Albin Michel, 2013
9782226245205
201 p., 16€50
Un article de Clarice Darling.
Aurais-je été résistant ou bourreau? de Pierre Bayard
 Et nous revoilà face au nouvel opus de Bayard, un bon auteur aux fortes accroches, qui brille toujours par le choix de ses titres. Après Comment parler des livres que l’on n’a pas lus, Saintes Ecritures pour tout libraire, après Comment parler des lieux où l’on n’a pas été, après Qui a tué Roger Ayckroyd?, après moults autres titres, voici Aurais-je été résistant ou bourreau? Le titre qui accroche inévitablement le regard, j’en ai fait l’expérience dans le métro parisien les jours passés.
Et nous revoilà face au nouvel opus de Bayard, un bon auteur aux fortes accroches, qui brille toujours par le choix de ses titres. Après Comment parler des livres que l’on n’a pas lus, Saintes Ecritures pour tout libraire, après Comment parler des lieux où l’on n’a pas été, après Qui a tué Roger Ayckroyd?, après moults autres titres, voici Aurais-je été résistant ou bourreau? Le titre qui accroche inévitablement le regard, j’en ai fait l’expérience dans le métro parisien les jours passés.
Pierre Bayard fait un commentaire de textes à partir de documents concernant les conflits rwandais ou bosniaque, la répression des Khmers rouges et bien sûr la Seconde Guerre mondiale. En s’appuyant sur des livres ou des documentaires, il a reconstitué ce qu’aurait pu être sa vie s’il était né comme son père en 1922, en tenant compte de sa famille, de ses études et de sa personnalité.
En découle un intéressant essai, à cheval entre philosophie, sociologie, histoire et psychanalyse. Bayard prend appui sur les récits de Justes parmi les nations, ou au contraire de personnes reconnues comme ayant été des bourreaux. Comment en sont-ils arrivés là? Comment peut-on tuer des gens par centaines, par milliers? Quel est l’élément déclencheur qui fait qu’on passe d’une personne lambda à un monstre ou un héros. Sans jamais porter de jugement, Pierre Bayard dissèque les récits de vie, recoupe les expériences menées par Milgram (passionnant!), et voit, au travers du prisme de son père, qui il aurait être pendant la Seconde Guerre mondiale. Héros? Résistant? Juste? Soldat? Tueur?
Au fond, ce n’est pas ce qui nous intéresse dans ce livre. C’est plutôt l’incroyable façon qu’a l’auteur de découper l’âme humaine et de se questionner sur la capacité d’obéissance, la rébellion, la peur de la mort et le désir de survivre.
Aurais-je été résistant ou bourreau? de Pierre Bayard
Editions de Minuit 2013
9782707322777
176p., 15€
Un article de Clarice Darling.
Les Cocottes, reines du Paris 1900 de Catherine Guigon
Halte! C’est bientôt Noël et vous n’avez pas de cadeau? Vous ne savez pas quoi offrir à votre grand-mère/oncle/belle-soeur ou même pour vous? Les Cocottes est LE livre qu’il vous faut!
 Catherine Guigon livre ici un ouvrage magnifiquement illustré, aux textes agréables et à la mise en page élégante, tout comme son sujet, les Cocottes de Paris. Mata-Hari pour la plus célèbre, mais également Liane de Pougy, Cléo de Mérode, Emilienne d’Alençon et autres jeunes filles réputées pour leur beauté autant que pour leurs qualités artistiques et leur gouaille inimitable. Sans parler de leur réputation de croqueuses d’hommes, voire de diamants!
Catherine Guigon livre ici un ouvrage magnifiquement illustré, aux textes agréables et à la mise en page élégante, tout comme son sujet, les Cocottes de Paris. Mata-Hari pour la plus célèbre, mais également Liane de Pougy, Cléo de Mérode, Emilienne d’Alençon et autres jeunes filles réputées pour leur beauté autant que pour leurs qualités artistiques et leur gouaille inimitable. Sans parler de leur réputation de croqueuses d’hommes, voire de diamants!
Toutes ces femmes connaîtront une ascension fulgurante au détour du XXe siècle, avant de tomber en désuétude au sortir de la Première Guerre Mondiale. Qui étaient-elles? Que sont-elles devenues? Quelles ont été leurs vies, si riches dans cette Belle Epoque puis plus rien, après 1914?
Témoins d’une époque révolue, ces Cocottes resplendissantes offrent dans ce livre une fois encore, l’éclat de leur jeunesse et la beauté de leur trait. Un ravissement!
Les Cocottes, reines du Paris 1900 de Catherine Guigon
Editions Parigramme, 2012
9782840967279
190p., 45€
Un article de Clarice Darling.
Sur la route du papier d’Erik Orsenna
Ex-prof d’histoire-géo ratée, j’avais été contrainte et forcée sous la torture par mes professeurs de feu l’IUFM de lire Voyage au pays du coton, du même auteur. J’avais adoré cet ouvrage. Plus de six ans après les faits, je m’en souviens encore, ce qui est pour moi assez rare. L’ouvrage était comme son sujet : léger tout en étant robuste, avec un je-ne-sais-quoi d’aérien dans l’écriture.
Ma vocation de géographe ayant été perturbée, je n’ai pas vu passer sous mes yeux L’Avenir de l’eau, paru en 2008, le tome 2 de ces Petits précis de mondialisation, comme il est indiqué sur la couverture. Voici donc qu’est sorti l’opus n°3 fin février.
 Le sujet est complexe. Mais les écrits d’Erik Orsenna sont extrêmement intéressants. On sent sa méticulosité et son amour du travail bien fait, sur un sujet qui lui tient à coeur, le papier.
Le sujet est complexe. Mais les écrits d’Erik Orsenna sont extrêmement intéressants. On sent sa méticulosité et son amour du travail bien fait, sur un sujet qui lui tient à coeur, le papier.
Cependant, je me suis parfois perdue dans les méandres de ma lecture. Un paragraphe, il est dans tel pays, quinze lignes plus loin, il est dans un autre… J’avoue avoir eu du mal à suivre notre énergique Académicien dans les recoins de la planète. Ma question fut, au détour des pages : pourquoi est-il là? Qui lui a dit qu’il y avait une papeterie ici? Mon esprit terre à terre sans doute. Le syndrome de la portière ouverte au cinéma, sûrement (mais si, vous avez toujours quelqu’un autour de vous qui remarque les petits détails au cinéma : l’inspecteur de police qui court après un méchant, alors qu’il a laissé les clés sur sa voiture, etc…)
Par contre, le gros point positif de cet ouvrage, outre le fait que vous connaîtrez tout de la déforestation en Indonésie et que vous pourrez parler du papier d’Echizen avec Monsieur Sennelier, LE magasin où les artistes du monde entier achètent leurs papiers à dessin, c’est qu’Erik Orsenna ne s’est pas attardé uniquement sur le papier au sens premier du terme, une simple feuille, un livre, un support pour écrire. Non. Il a cherché le papier dans tous les sens du terme. Y compris le papier hygiénique.
En résumé, Sur la route du papier est un documentaire passionnant, tout en constituant en quelque sorte les mémoires d’Orsenna. Un tome parfois un peu indigeste, mais mené à bon port avec maestria par l’auteur. Un bel ouvrage qui conclut fort bien une trilogie. Tout comme Le retour du Jedi était la fin parfaite pour la Guerre des étoiles.
Sur la route du papier d’Erik Orsenna
Editions Stock, 2012
9782234063358
310p., 21€50
Un article de Clarice Darling.
Les hémorroïdes de Napoléon de Phil Mason et les morts mystérieuses de l’Histoire d’Augustin Cabanès
Les hémorroïdes de Napoléon de Phil Mason
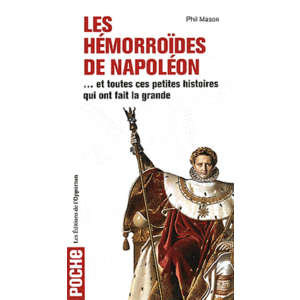 Forcément, ce qui m’a plu, c’est le titre. Oui, on oublie que Napoléon avait eu des hémorroïdes et qu’Hitler avait sûrement eu la diarrhée. Non, on ne savait pas que Picasso avait été déclaré mort-né par la sage-femme et sauvé in-extremis par son oncle, et qu’il restait mois d’une minute de carburant à Neil Armstrong avant de poser Apollo 11.
Forcément, ce qui m’a plu, c’est le titre. Oui, on oublie que Napoléon avait eu des hémorroïdes et qu’Hitler avait sûrement eu la diarrhée. Non, on ne savait pas que Picasso avait été déclaré mort-né par la sage-femme et sauvé in-extremis par son oncle, et qu’il restait mois d’une minute de carburant à Neil Armstrong avant de poser Apollo 11.
Les hémorroïdes de Napoléon est un ouvrage très divertissant, drôle, concis, précis. Idéal pour tout amateur d’histoire qui en a marre de lire plus ou moins les mêmes choses. Par contre, pour les historiens purs et durs (les historiens « chiants » dont j’ai l’audace de m’auto-désigner dans cette catégorie), il est probablement sûr qu’ils voudront vérifier les sources. Et de sources, il n’en est point. Certes, c’est un poche. Peut-être sont-elles dans la publication grand format?
Les hémorroïdes de Napoléon de Phil Mason
Editions de l’Opportun, 2012
9782360750900
275p., 6€90
Les morts mystérieuses de l’Histoire d’Augustin Cabanès
 Dans le même registre, beaucoup plus détaillé, vous trouverez Les morts mystérieuses de l’Histoire, de Charlemagne à Louis XIII (volume 1) du Docteur Cabanès.
Dans le même registre, beaucoup plus détaillé, vous trouverez Les morts mystérieuses de l’Histoire, de Charlemagne à Louis XIII (volume 1) du Docteur Cabanès.
Ce médecin, féru d’histoire, avait publié entre 1901 et 1911 les deux volumes des Morts mystérieuses de l’Histoire. Augustin Cabanès est reconnu dans deux domaines, la médecine, qu’il a pratiqué et l’histoire. Il fut un des pionniers de l’histoire de la médecine et ses écrits alliant ses deux passions furent les best-sellers de l’époque. Drôles, très documentées, ces anecdotes fourmillent de détails croustillants écrits de façon réjouissante et laissent un sourire sur les lèvres du lecteur. Réédité plus de cent ans après, Les morts mystérieuses de l’Histoire est un ouvrage à mettre entre toutes les mains. Une question reste en suspens… comment est mort le Docteur Cabanès?
Les morts mystérieuses de l’Histoire d’Augustin Cabanès
Edition de l’Opportun, 2012
9782360750849
334p., 6€90
Un article de Clarice Darling.
Et la fête continue d’Alan Riding
Vous saviez, vous, que le frère de notre bon commandant Cousteau était un collabo de la première heure? Vous saviez que Dina Vierny, la muse de Maillol, faisait passer en douce des clandestins depuis la gare de Banyuls? Vous saviez que Gerhard Heller, officier nazi, avait cependant joué un grand rôle dans la vie culturelle française et avait sauvé la vie de Jean Paulhan? Connaissez-vous seulement l’existence de Rose Valland et toutes les oeuvres d’art qu’elle a sauvées?
Si oui, vous pouvez quand même apprendre des foules de choses sur cette période sombre de l’Histoire qu’est la vie culturelle sous l’Occupation. Si non, vous apprendrez des foules de choses sur cette période sombre de l’Histoire qu’est l’Occupation.
 Alan Riding, correspondant du New York Times, a travaillé pendant plus de dix ans sur cet ouvrage et nous livre un documentaire extrêmement méticuleux, bien fourni, et surtout, bien écrit qui vous replongera au coeur des années noires. Formidablement documenté, cet essai retrace l’évolution des artistes pendant toute la période de l’Occupation. Personne n’est oublié. Les chanteurs populaires ou les grandes voix de l’Opéra, les poètes, les philosophes, les écrivains, les journalistes, les peintres, les sculpteurs, les photographes, les danseurs, les comédiens et metteur en scène, les producteurs de cinéma… Tout le monde y passe. Sous forme chronologique, Alan Riding nous livre un panorama complet de la vie culturelle, avec l’aide de Danielle Darrieux, Stéphane Hessel, Micheline Presle, Françoise Gilot, Pierre Boulez et bien d’autres.
Alan Riding, correspondant du New York Times, a travaillé pendant plus de dix ans sur cet ouvrage et nous livre un documentaire extrêmement méticuleux, bien fourni, et surtout, bien écrit qui vous replongera au coeur des années noires. Formidablement documenté, cet essai retrace l’évolution des artistes pendant toute la période de l’Occupation. Personne n’est oublié. Les chanteurs populaires ou les grandes voix de l’Opéra, les poètes, les philosophes, les écrivains, les journalistes, les peintres, les sculpteurs, les photographes, les danseurs, les comédiens et metteur en scène, les producteurs de cinéma… Tout le monde y passe. Sous forme chronologique, Alan Riding nous livre un panorama complet de la vie culturelle, avec l’aide de Danielle Darrieux, Stéphane Hessel, Micheline Presle, Françoise Gilot, Pierre Boulez et bien d’autres.
Le point fort de Riding, c’est de ne pas prendre parti. Il parle aussi bien des artistes français que des officiers allemands importants qui ont contribué ou non à la culture française : l’ambassadeur Otto Abetz, Gerhard Heller, etc. Il parle des amitiés malgré les divergences politiques ( Marcel Jouhandeau et Jean Paulhan, Jean Cocteau et Arno Breker), il a pioché dans tous les journaux intimes disponibles (Ernst Jünger, Galtier-Boissière, Jean Guéhenno…), il a reconstitué pour chaque personne sa chronologie pendant ses 5 années de guerre.
Si vous ne devez retenir qu’un ouvrage sur la vie culturelle pendant l’Occupation, Et la fête continue est celui-là. Fourni, bien écrit, remarquable. Vraiment.
Et la fête continue d’Alan Riding
Editions Plon, 2012
ISBN 978 2 259 214810
411p., 23€90
Un article de Clarice Darling.
















