LES JOIES INFINIES DU DÉFRICHAGE OU LES APPRENTISSAGES D’UN LIBRAIRE #2

Jonathan Coe est l’un des rares écrivains dont j’ai lu tous les romans, du premier (Une femme de hasard, très dispensable) au dernier en date (Les preuves de mon innocence, paru cette année et tout à fait excellent). Je précise bien « romans », car Coe a également écrit quelques essais, notamment sur le cinéma, que je n’ai pas eu l’occasion de lire, sauf le remarquable Notes marginales et bénéfices du doute qui compile un certain nombre d’articles publiés sur des sujets divers au fil des années.
Si je mentionne ce détail, ce n’est pas pour me faire mousser, mais pour révéler à quel point cet auteur compte pour moi. Étant donné le succès qui est le sien depuis bientôt trente ans, cela n’a rien de bien original, mais j’ai tout de même entendu suffisamment de choses un peu méprisantes à son sujet pour avoir envie de le défendre aujourd’hui.
Méprisantes, oui, à tout le moins condescendantes : il paraîtrait que Jonathan Coe ne serait qu’un écrivain moyen. Pas très inspiré dans son écriture, fluide certes, agréable à lire, mais dont rien ne semble vraiment émerger, comme si elle n’était que la surface paisible d’un lac sur lequel il suffit de se laisser glisser. À mon sens, c’est tout de même mal connaître ou mal lire le bonhomme.
C’est vrai, quand on lit Coe, on a l’impression qu’écrire est facile. Cette capacité à gommer tout le labeur qu’il y a dans l’expression du style, à bien cacher les mécanismes qui animent sa scène romanesque, constitue précisément, pour moi, la marque d’un grand. Certains écrivains peuvent se permettre d’être flamboyants parce qu’ils ont le grand spectacle des mots dans le sang, et parce que leur écriture se prête à leur propos. Jonathan Coe, lui, met sa plume tout entière au service de ses intrigues, de ses personnages et de son propos, derrière lesquels il entend disparaître, tout en leur donnant les moyens littéraires pour exister pleinement.
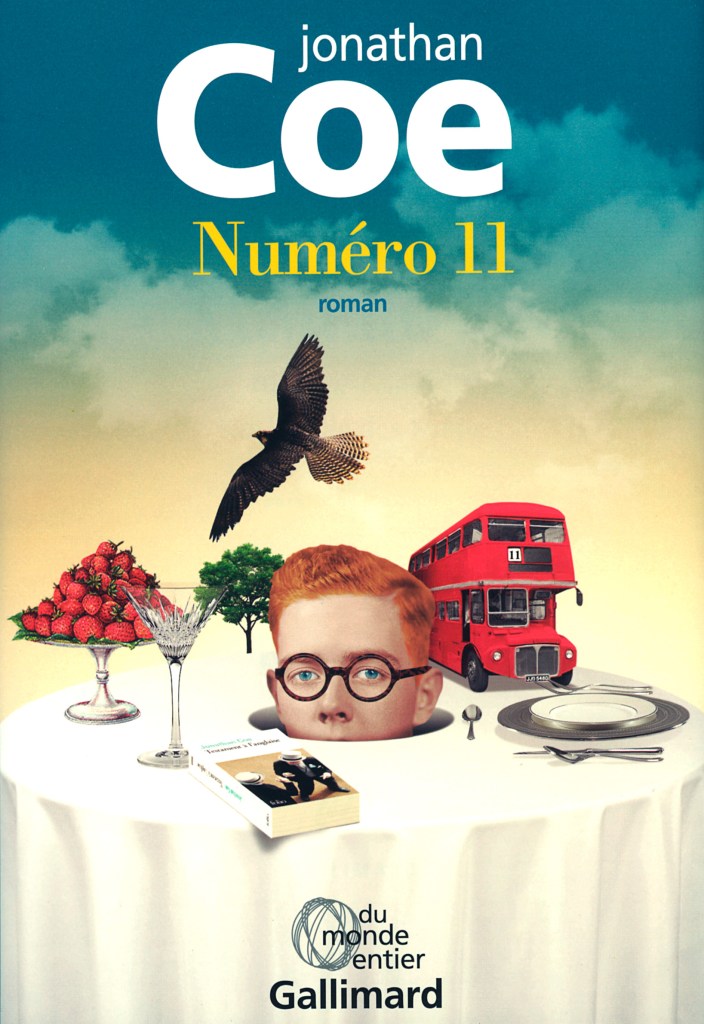
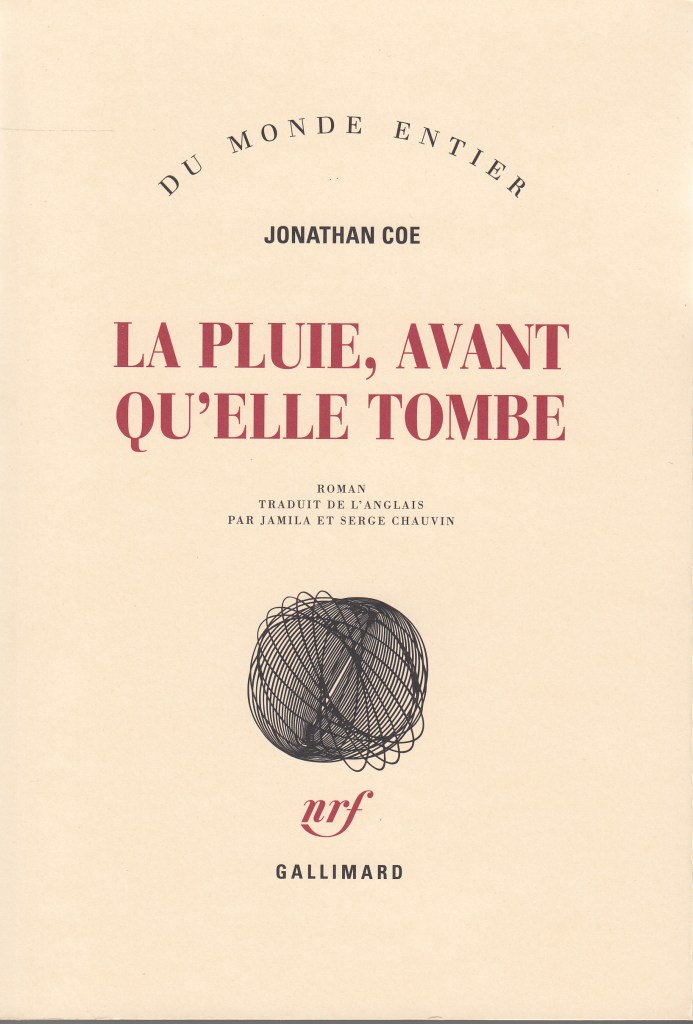
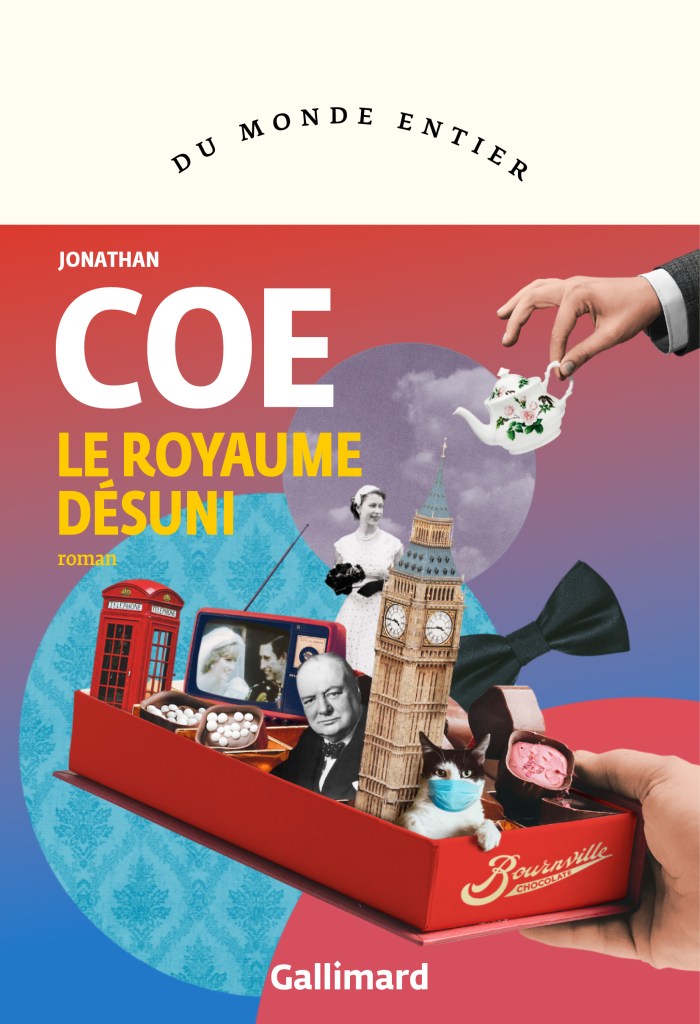
Ce travail minutieux donne effectivement une grande souplesse à la lecture de ses romans. On y plonge sans effort, aidé par son humour quasi constant, ce fameux « british humor » qui n’appartient qu’à nos amis anglais et dont nous devrions tous être fortement jaloux, tant il est à la fois exquis, mordant et spirituel. Dans ce registre, Coe est un maître.
Et, bien sûr, il est totalement faux d’affirmer qu’il n’a pas de style. Ses romans sont loin d’être similaires, précisément parce qu’il s’autorise des variations plus ou moins visibles dans leur écriture et leur structure, en fonction de ce qu’il veut raconter. Ce n’est peut-être pas flagrant, ni spectaculaire. Mais une étude attentive de la mise en œuvre, par exemple, de La Pluie, avant qu’elle tombe, Numéro 11 et Le Royaume désuni, suffit à se rendre compte qu’il y a une véritable pensée d’écriture derrière chacun d’eux, et qu’aucun ne se ressemble vraiment.
Si l’on s’en tient seulement à deux romans sortis l’un après l’autre, Testament à l’anglaise et La Maison du sommeil, les différences sont flagrantes. Pas le même rythme, pas la même atmosphère (cinglante dans le premier, vaporeuse dans le second), pas la même manière d’en approcher le sujet.
Pas la même construction non plus : là où Testament à l’anglaise multiplie les personnages pour traverser les années 80, La Maison du sommeil joue sur les allers-retours temporels pour égarer à dessein son lecteur et mieux le surprendre à la fin.
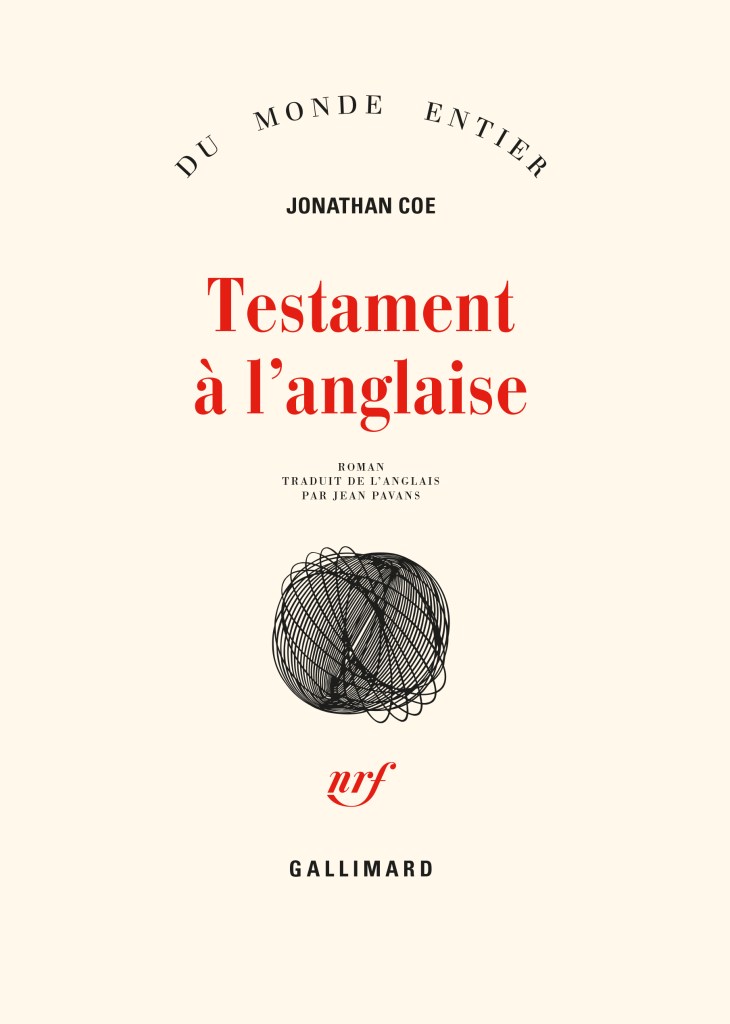
Tiens, et puisque nous sommes sur Testament à l’anglaise, qui est après tout l’objet principal de cette chronique, et le livre qui m’a fait découvrir Jonathan Coe, restons-y.
Après trois premières tentatives un peu fragiles (La Femme de hasard, Une touche d’amour et Les nains de la mort), ce quatrième roman pose les fondements solides de ce qui va devenir l’une des marques de fabrique du romancier anglais : s’emparer d’une période précise de l’histoire britannique, si possible une décennie – ici les années 80, donc – et la passer au crible à travers le destin de ses personnages qui en épousent les caractères et en suivent quelques dates décisives.
Après ce triomphe initial, Coe reprendra régulièrement le même procédé avec bonheur, par exemple dans le diptyque Bienvenue au club et Le Cercle fermé (années 70 et 90 en miroir), ou en élargissant le spectre temporel pour rythmer le récit de dates déterminantes dans l’excellent Royaume désuni par exemple.

Dans Testament à l’anglaise, il s’agit donc des années Thatcher, que Coe ne porte à l’évidence pas dans son cœur (on se demande bien pourquoi). Pour représenter cette décennie que la Dame de Fer a marquée de son empreinte, il crée de toutes pièces une famille infernale, les Winshaw, qui va en incarner les pires travers : opportunisme politique et/ou économique, décomplexion morale et éthique, éloge de la désinformation agressive et intéressée (eh oui, déjà !), magouilles en tous genres, spéculations financières sur le dos des plus faibles (eh oui, déjà…) ou capitalisme galopant, tout y passe.
Dans tout le roman, il n’y en a pratiquement pas un pour rattraper les autres – et pourtant, on se régale, grâce à la plume acerbe de Jonathan Coe, à son regard féroce et intraitable, et à son art de la mise en scène qui permet une montée en tension impeccable pour dénouer toute l’histoire dans un final réjouissant de cruauté expiatoire. Une vengeance littéraire qui rend hommage à la malice narrative de la grande Agatha Christie, et soulage le lecteur d’avoir affronté tant de maux au fil des six cents pages précédentes.
Pour une fois, je ne me rappelle pas précisément comment ce roman m’est tombé entre les mains. Je l’ai découvert lors de mon premier stage en librairie, j’en suis certain, mais pourquoi et dans quelles circonstances, aucun souvenir précis.
Tout ce dont je suis certain, c’est que je me suis empressé de lire La Maison du sommeil, qui venait de paraître en France, juste après avoir refermé Testament à l’anglaise. Signe que j’étais déjà bien mordu, et prêt à m’emparer d’une œuvre dont je continue à prendre un immense plaisir à suivre l’évolution, avec des fortunes diverses, ce qui est bien normal, mais souvent avec la satisfaction intacte de retrouver tout ce que j’aime dans l’écriture et dans la manière de voir le monde de son auteur.

Une anecdote pour conclure cette chronique encore une fois beaucoup trop longue, veuillez m’en excuser. Bavard un jour…
Dans ma carrière de libraire, j’ai longtemps rêvé d’inviter Jonathan Coe pour une soirée autour de l’un de ses livres. J’ai beaucoup harcelé mes représentants Gallimard, mais sans succès. Coe ne venait pas en France, ou pas assez longtemps, ou il était déjà programmé ailleurs…
Jusqu’en 2014, date à laquelle paraît Expo 58, une délicieuse comédie d’espionnage douce-amère qui se déroule durant l’Exposition Universelle de Bruxelles en 1958. Cette fois, feu vert : Jonathan Coe sera bel et bien l’invité de la librairie Le Comptoir des Mots à Paris, où j’officie alors depuis presque dix ans.
Joie immense – assez vite douchée : la date proposée par Gallimard tombe en plein milieu de ma semaine de vacances d’hiver, pour laquelle tout est déjà programmé ; je serai loin de Paris, impossible de revenir ni d’annuler… À regret, je confie donc l’événement à mes collègues, qui s’en tirent évidemment fort bien et font librairie comble. Je manque Sir Coe, pour une excellente raison, certes, mais tout de même.
Par la suite, je continue mon lobbying, mais sans plus de succès. Je ne recevrai jamais Jonathan Coe en tant que libraire.
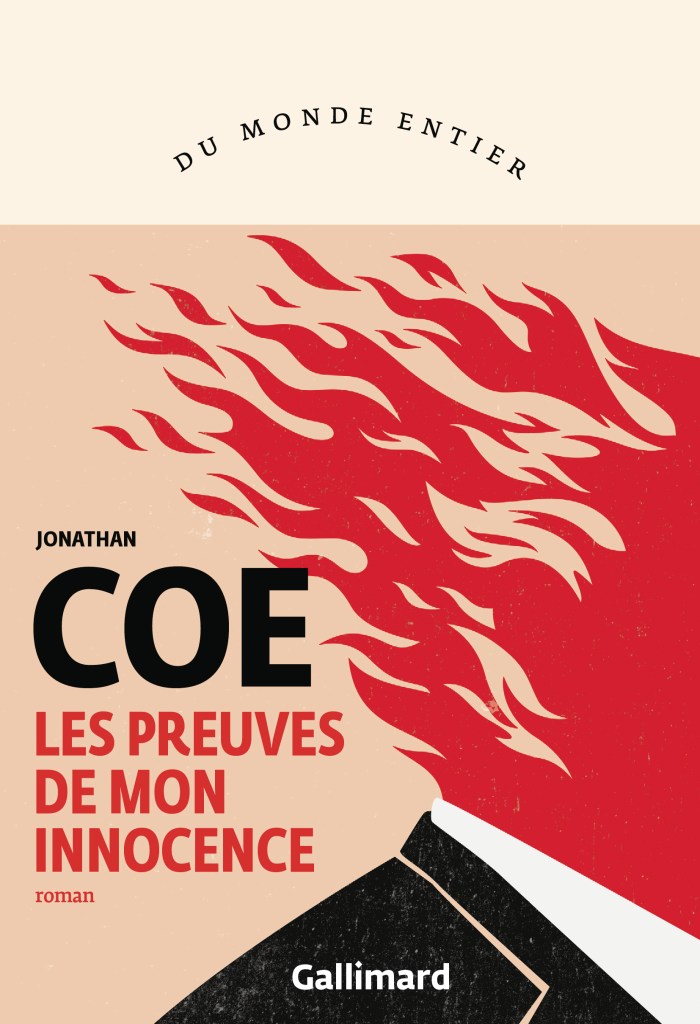
Mais…
Cette année, mes anciens collègues de la librairie Passages à Lyon ont eu le privilège de se voir proposer une soirée avec lui, à l’occasion de la parution de son nouveau roman, Les preuves de mon innocence.
C’était au début du mois d’octobre, et j’y étais.
ENFIN, j’ai pu rencontrer l’un de mes écrivains favoris, l’entendre parler avec toute la fantaisie et l’intelligence qui sont les siennes, et discuter avec lui. Grâce à mes camarades, que je remercie publiquement pour ce somptueux cadeau, j’ai même pu partager le dîner traditionnellement offert à l’auteur par les libraires et m’inviter à la table de Jonathan Coe.
On est parfois déçu de rencontrer ses modèles ou ses sources d’inspiration, ceux dont les œuvres et le travail vous ont un peu façonné, mais pas cette fois. Ce fut un moment merveilleux, dans une admiration sincère et avec une simplicité revigorante, comme seule la littérature a jamais pu m’en apporter.

Laisser un commentaire