Lorsque le dernier arbre, de Michael Christie
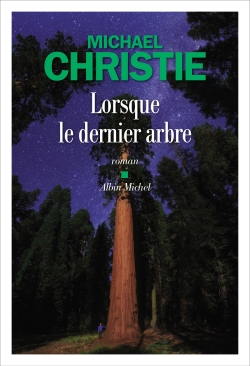
Éditions Albin Michel, 2021
ISBN 9782226441003
608 p.
22,90 €
Greenwood
Traduit de l’anglais (Canada) par Sarah Gurcel
Les vagues épidémiques du Grand Dépérissement ont décimé tous les arbres et transformé la planète en désert de poussière. L’un des derniers refuges est une île boisée au large de la Colombie-Britannique, qui accueille des touristes fortunés venus admirer l’ultime forêt primaire. Jacinda y travaille comme de guide, sans véritable espoir d’un avenir meilleur.
Jusqu’au jour où un ami lui apprend qu’elle serait la descendante de Harris Greenwood, un magnat du bois à la réputation sulfureuse…
Il faudrait tout de même qu’on m’explique un jour par quel miracle il y a, en Amérique du Nord, autant d’auteurs capables de sortir de nulle part pour balancer des romans énormes, tant par le volume que par le contenu. Des pavés géniaux, brillants, menés avec une telle perfection apparemment sans effort qu’ils en deviennent imparables.
Je ne vais pas citer d’exemples, vous en avez sûrement tous au moins un en tête. Sachez juste que le Canadien Michael Christie s’inscrit, avec ce deuxième roman éblouissant (le premier n’a pas été traduit en France, à la différence du recueil de nouvelles qui a introduit son œuvre, Le Jardin du mendiant), dans ce registre admirable dont nous ne pouvons qu’être un peu jaloux de notre côté de l’Atlantique.
Imparable, je l’ai dit. Impossible de résister à la construction en spirale de Lorsque le dernier arbre, qui nous attrape en 2038, dans un futur proche et anxiogène terriblement réaliste, pour nous conduire au cœur du livre jusqu’en 1908, au fil de bonds générationnels passant par 2008, 1974 et 1934 ; avant de repartir dans le sens inverse par les mêmes étapes pour nous ramener, à bout de souffle et étourdis d’admiration, à la case départ.
Sauf qu’entre les deux, nous aurons découvert toute l’histoire de la famille Greenwood, en particulier sa « fondation » en 1908 (cette partie centrale, différente même du reste dans sa narration – posée par un « nous » collectif et un passage au passé, alors que le reste du récit est au présent -, est à la fois déterminante et incroyablement brillante), et les liens qu’elle entretient durant plus de cent ans avec les arbres.
Comme son titre l’indique, Lorsque le dernier arbre est un roman dendrologique. Le récit plonge au cœur du passé selon des cercles concentriques qui rappellent les cernes d’un tronc d’arbre grâce auxquels on peut déterminer son âge, et connaître les différentes étapes de sa vie.
Du péril fictionnel en 2038 d’un déboisement quasi total de la planète, et des conséquences terrifiantes que cela pourrait avoir sur la survie des espèces vivantes – y compris la nôtre, bien sûr -, Michael Christie remonte dans le temps pour décrire la manière dont les humains exploitent la nature sans autre considération que celle de ses intérêts et profits.
Il tente d’opposer à cette folie spéculative le combat de quelques résistants, à l’image de Willow, fille de l’exploitant sans scrupule Harris Greenwood, dont l’activisme utopique paraît bien fragile, voire risible, face à la puissance du capitalisme dans toute sa splendeur. Ou de décrire la manière dont certains, tel Everett Greenwood, le frère de Harris, conçoivent les forêts comme abri ultime où réfugier leur désir profond de solitude et de tranquillité, ou leur besoin de se cacher des poursuites et de la violence des hommes.
N’allez pas imaginer pour autant que le roman cède à la facilité du manichéisme – les « gentils » écolos contre les « méchants » exploiteurs. On en est même loin ! Tous les personnages ont leurs failles, leurs raisons d’être, leurs ombres et leurs lumières. Leur profondeur inouïe, qui se découvre peu à peu, est l’une des grandes forces et beautés du roman.
De part et d’autre de la brève partie consacrée aux événements fondateurs de 1908, la plus grosse partie de Lorsque le dernier arbre se concentre sur l’année 1934. S’y développe un périple steinbeckien d’une puissance inouïe, rehaussé de péripéties et de rebondissements captivants, mais aussi et surtout de personnages dont la grandeur tragique a quelque chose de shakespearien. On comprend que les autres cernes du roman ne sont là que pour éclairer les choix et les parcours des magnifiques Everett, Harris, Temple, Liam Feeney, Harvey Lomax, Euphemia Baxter, et la petite Gousse bien sûr, et tous ceux dont ils croisent la route.
Cette immense double partie est balayée de poussière et de vent, résonne du fracas des trains sur les rails, se perd dans les vapeurs d’opium, vibre à l’accent inimitable d’un poète irlandais ou à l’amour imprévisible d’un vétéran de la Première Guerre mondiale pour une petite fille trouvée… accrochée à un arbre (inévitablement). Elle justifie à elle seule d’accoler au roman de Michael Christie le qualificatif de grand livre – histoire de pas abuser du trop galvaudé « chef d’œuvre », que quelques légères baisses d’intensité (notamment dans les parties plus contemporaines) empêchent de convoquer ici. Mais on n’en est vraiment pas loin du tout.
Au bout du compte, Lorsque le dernier arbre rejoint quelques glorieux aînés littéraires au panthéon des grands romans mettant en parallèle l’histoire des arbres et celle des hommes, associant récit historique, considérations dendrologiques, démesure tragique, puissance visionnaire et réflexions sociologiques de tout premier ordre. Et tient toute sa place aux côtés de L’Arbre-Monde de Richard Powers, ou Serena de Ron Rash.
Il y a pire, comme compliment.
Sans lendemain, de Jake Hinkson

Dans les années 40, Billie Dixon, femme au prénom d’homme et aux mœurs beaucoup trop libres pour son époque, sillonne les États-Unis pour livrer aux cinémas des coins les plus reculés du Midwest les films médiocres d’un obscur studio hollywoodien. Dans un petit bled de l’Arkansas, elle se heurte à la vindicte d’un pasteur aussi charismatique que fanatique, pour qui le cinéma est l’une des plus terribles incarnations du Diable. Billie aurait bien passé son chemin sans tarder, seulement il y a Amberly, la femme du pasteur. Une beauté renversante, totalement déplacée dans cette de bouseux arriérés, le genre de fille incendiaire et délicieusement mystérieuse qui affole les sens de la vendeuse de films. Pour elle, Billie serait prête à faire n’importe quoi.
Et c’est exactement ce qui va se passer.
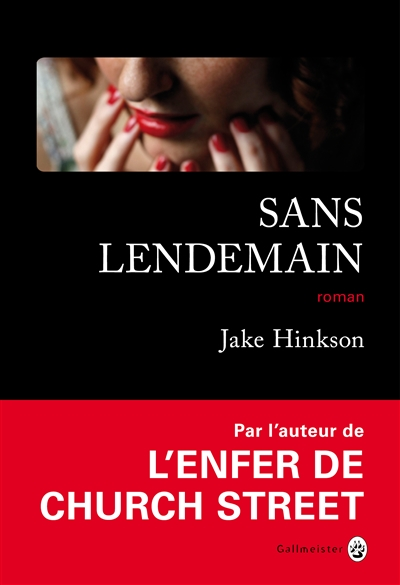 Après un Homme posthume plutôt oubliable, Jake Hinkson est de retour en grande forme, largement au niveau de L’Enfer de Church Street si ce n’est plus. Plus ambitieux, plus complexe en tout cas, c’est certain.
Après un Homme posthume plutôt oubliable, Jake Hinkson est de retour en grande forme, largement au niveau de L’Enfer de Church Street si ce n’est plus. Plus ambitieux, plus complexe en tout cas, c’est certain.
Sans lendemain est de prime abord un pur roman noir à l’américaine, impression confortée par le choix de l’époque de l’intrigue (la fin des années 40) et par le recours à des codes classiques du genre : femme fatale, personnages étranges, références cinématographiques, paysages inquiétants… Comme dans son premier roman, Hinkson confirme sa maîtrise totale de ce registre particulier, auquel il apporte pourtant une patte personnelle et une touche de modernité bienvenue.
En effet, les héros de cette tragédie rurale sont avant des héroïnes – des femmes diablement en avance sur leur temps, mine de rien. Outre Billie, manipulatrice de premier ordre et fille d’une liberté ébouriffante, et Amberly, femme fatale beaucoup plus tordue qu’il n’y paraît, il y a aussi Lucy, officiellement assistante de son shérif de frère – officieusement shérif en chef, car son frère est totalement idiot et incapable de la moindre décision autonome.
Autour de ce trio qui ne s’en laisse pas compter, les hommes en prennent souvent pour leur grade, à commencer par le pasteur, qui cumule le défaut d’être un mâle à celui, rédhibitoire chez Jake Hinkson, de proférer la parole de Dieu sans aucune nuance. Toujours traumatisé par une enfance intensément religieuse, le romancier américain traque avec obstination les hypocrisies et la violence sous-jacente des fidèles aveuglés par une foi sans réflexion – ce qui donne à l’occasion quelques scènes hilarantes, comme la rédemption soudaine de Billie au milieu d’un cercle de grenouilles de bénitier déchaînées…
Dynamisé par sa brièveté, sa trajectoire inexorable et son style sans fioriture (magnifiquement restitué par la traduction de Sophie Aslanides), Sans lendemain permet à Jake Hinkson de retrouver l’énergie, la drôlerie et le sens du drame qui faisaient de L’Enfer de Church Street un coup d’essai très prometteur. Un roman noir exemplaire et réjouissant.
Sans lendemain, de Jake Hinkson
(No tomorrow, traduit de l’américain par Sophie Aslanides)
Éditions Gallmeister, 2018
ISBN 978-2-35178-132-6
224 p., 19,90€
A première vue : la rentrée Stock 2016
À première vue, chez Stock comme chez la plupart des éditeurs, on voit arriver une rentrée sérieuse comme un premier de la classe, mais manquant clairement de fantaisie (à une exception près peut-être). C’est déjà pas mal, me direz-vous. Mouais, mais on n’aurait rien contre un peu d’excitation et d’inattendu. Pas sûr de les trouver sous la couverture bleue de la vénérable maison désormais dirigée par Manuel Carcassonne, qui aligne de plus beaucoup (trop) de candidats sur la ligne de départ : neuf auteurs français, deux étrangers, ça sent la surchauffe…
 AUCUN LIEN : Une fille et un flingue, d’Olivier Pourriol
AUCUN LIEN : Une fille et un flingue, d’Olivier Pourriol
Elle est sans doute là, la touche de folie de la rentrée Stock ! Ancien chroniqueur littéraire muselé du Grand Journal (expérience amère dont il a tiré un récit décapant, On/Off), mais aussi et surtout spécialiste de cinéma, Pourriol met en scène deux frangins, Aliocha et Dimitri, fans de cinoche et obsédés par le désir de réaliser un film. Comment y parvenir quand on est fauché et inconnu ? En appliquant à la lettre le précepte d’un grand maître du Septième Art : « Un film, c’est un hold up » (Luc B.) Un « braquage » que les deux frères vont tenter de réussir avec l’aide de Catherine D. et Gérard D., en plein Festival de Cannes… Annoncé comme une comédie délirante, Une fille et un flingue est le genre de bouquin qui passe ou qui casse, sans juste milieu. Pourriol a tout le talent médiatique nécessaire pour défendre son livre sur les plateaux de télévision, mais son livre saura-t-il se défendre tout seul ?
 GENÈSE II, LA REVANCHE : Au commencement du septième jour, de Luc Lang
GENÈSE II, LA REVANCHE : Au commencement du septième jour, de Luc Lang
Je n’ai jamais rien lu de Luc Lang, auteur emblématique de Stock, faute d’avoir réussi à m’intéresser à son travail jusqu’à présent. Cela changera peut-être avec ce nouveau roman, récit d’une vie trop parfaite pour être honnête et qui s’écroule brutalement lorsque la supercherie est dévoilée. Cette vie, c’est celle de Thomas, dont la femme Camille a un jour un terrible accident de voiture à un endroit où elle n’aurait jamais dû se trouver. Tandis que Camille reste plongée dans le coma et que tout s’écroule autour de lui, Thomas entame une vaste enquête qui va lui faire passer en revue toute son existence, sa relation avec son père, ses frère et soeur, ses enfants… Luc Lang revendique l’inspiration de Cormac McCarthy (rien de moins) pour ce roman présenté par son éditeur comme son plus ambitieux.
 ALLÔ PAPA TANGO CHARLIE : Bronson, d’Arnaud Sagnard
ALLÔ PAPA TANGO CHARLIE : Bronson, d’Arnaud Sagnard
Premier roman qui met en parallèle une ligne autobiographique et la vie du comédien Charles Bronson, depuis une jeunesse misérable durant la Grande Dépression jusqu’à la gloire hollywoodienne, renommée et richesse dissimulant la hantise quotidienne d’un homme rongé par la peur. Ce genre d’exercice a déjà donné de fort belles choses, notamment sous la plume de Florence Seyvos (Un garçon incassable, autour de Buster Keaton), alors pourquoi pas ?
 C’EST UNE MAISON BLEUE : Les visages pâles, de Solange Bied-Charreton
C’EST UNE MAISON BLEUE : Les visages pâles, de Solange Bied-Charreton
Les trois petits-enfants de Raoul Estienne se retrouvent dans la vieille demeure chargée de souvenirs du vieil homme qui vient de s’éteindre. Faut-il vendre la maison ou la garder ? La question agite les héritiers autant que la Manif pour Tous, au même moment, déchire la société française, et oblige les uns et les autres à faire le point sur leurs existences… Je ne sais pas s’il faut attendre grand-chose d’un roman dont les personnages se prénomment Hortense, Charles ou Alexandre, mais bon. Il paraît que c’est « caustique » (dixit l’éditeur).
 C’EST L’AMOUR A LA PLAGE (AOU CHA-CHA-CHA) : Maures, de Sébastien Berlendis
C’EST L’AMOUR A LA PLAGE (AOU CHA-CHA-CHA) : Maures, de Sébastien Berlendis
Les vacances d’été, la mer, les dunes, le camping, le dancing, l’adolescence, la découverte des filles… Tout ceci est follement original, n’est-ce pas ? Déjà vu, déjà lu, il faudrait vraiment une plume exceptionnelle ou un point de vue extrêmement singulier pour distinguer un tel récit. Toujours possible, mais on n’y croit guère…
 POKER FACE : L’Indolente, de Françoise Cloarec
POKER FACE : L’Indolente, de Françoise Cloarec
En 2008, Françoise Cloarec avait signé un succès surprise avec La Vie rêvée de Séraphine de Senlis (qui avait donné une adaptation cinématographique non moins triomphale, Séraphine, avec Yolande Moreau). Elle revient au milieu de la peinture avec cette enquête littéraire sur Marthe Bonnard, dont on découvre après le décès de son peintre de mari, Pierre Bonnard, qu’elle n’était pas du tout celle qu’elle avait toujours prétendu être.
 DANS DEUX CENTS MÈTRES, TOURNEZ A GAUCHE : À tombeau ouvert, de Bernard Chambaz
DANS DEUX CENTS MÈTRES, TOURNEZ A GAUCHE : À tombeau ouvert, de Bernard Chambaz
Le 1er mai 1994, le pilote Ayrton Senna se tue au volant de sa Formule 1, en ratant un virage et en allant s’écraser contre un mur à 260 km/h. A partir de ce drame diffusé en direct et en mondovision télévisuelle, Bernard Chambaz tire un roman sur la fascination pour la vitesse, croisant le destin de Senna avec ceux d’autres pilotes célèbres mais aussi avec ceux de ses proches, dont son fils mort dans un accident de la route.
 L’AMANTE DU VIETNAM DU NORD : L’Éveil, de Line Papin
L’AMANTE DU VIETNAM DU NORD : L’Éveil, de Line Papin
Stock lance une auteure de 20 ans dans l’arène, avec un premier roman sous forte influence de Marguerite Duras, une histoire d’amour torride dans la touffeur de Hanoï, la capitale du Vietnam (où est née Line Papin). On annonce une jeune prodige, il faudra voir si elle est authentique.
 AU CHARBON : Anthracite, de Cédric Gras
AU CHARBON : Anthracite, de Cédric Gras
Dans un décor de guerre, une tragi-comédie sur fond de pays qui s’écroule – ce pays, c’est l’Ukraine, violemment divisée après la sécession en 2014 de la région minière du Donbass qui décide de rejoindre la Russie. Parce qu’il s’est obstiné depuis l’événement à y faire jouer l’hymne national ukrainien, un chef d’orchestre est obligé de prendre la fuite avec son ami d’enfance à bord d’une bagnole aussi décrépite que les paysages industriels qu’ils traversent… Premier roman.
*****
L’ÉNERGIE EST NOTRE AVENIR, ÉCONOMISONS-LA : Un travail comme un autre, de Virginia Reeves
Alabama, années 20. Avec l’aide de son ouvrier agricole, un fermier détourne une ligne électrique de l’Etat pour augmenter le rendement de son exploitation. Tout roule jusqu’à ce qu’un employé paye de sa vie cette installation sauvage. Wilson, l’ouvrier, écope des travaux forcés dans les mines, tandis que son patron est envoyé au pénitencier. Confronté à la violence extrême de la prison, il tente tout de même d’envisager l’avenir… Premier roman de l’Américaine Virginia Reeves.
POÉTER PLUS HAUT QUE SON… : Ce qui reste de la nuit, d’Ersi Sotiropoulos
En 1897, Constantin Cavafy n’est pas encore le grand poète grec qu’il est appelé à devenir. Écrasé par l’affection de sa mère, tourmenté par son homosexualité, à la recherche de son style et de sa voix, il fait un séjour de trois jours à Paris qui va tout changer pour lui. La romancière grecque Ersi Sotiropoulos dresse un portrait littéraire de Cavafy en s’interrogeant sur le lien entre création et désespoir, dans un livre dense et exigeant (une manière polie de suggérer autre chose, je vous laisse deviner quoi).
Vivre vite, de Philippe Besson
Signé Bookfalo Kill
Pour jouer brillamment de certaines formes littéraires ambitieuses, il faut en avoir les moyens techniques. Disons-le d’emblée : en ce qui concerne le roman choral, Philippe Besson n’est pas à la hauteur.
 Oui, je sais, l’entrée en matière est un peu abrupte, mais elle est à l’image de la déception qui m’a saisi dès les premières pages de Vivre vite. N’étant pas un lecteur assidu de Besson, ni un admirateur transi de James Dean, sujet du livre (la couverture vous l’aura déjà appris), je n’en attendais pourtant rien de spécial. Il me semblait que ce pouvait être l’un des titres importants de cette rentrée de janvier ; étant donné ce que j’ai lu depuis de cette vague de parutions hivernales, il paraîtrait qu’il en est effectivement représentatif, mais par sa médiocrité.
Oui, je sais, l’entrée en matière est un peu abrupte, mais elle est à l’image de la déception qui m’a saisi dès les premières pages de Vivre vite. N’étant pas un lecteur assidu de Besson, ni un admirateur transi de James Dean, sujet du livre (la couverture vous l’aura déjà appris), je n’en attendais pourtant rien de spécial. Il me semblait que ce pouvait être l’un des titres importants de cette rentrée de janvier ; étant donné ce que j’ai lu depuis de cette vague de parutions hivernales, il paraîtrait qu’il en est effectivement représentatif, mais par sa médiocrité.
Rangeons (brièvement) les crocs pour entrer dans le roman. Pour raconter la trajectoire de comète de James Dean, Philippe Besson a donc choisi de donner la parole, non seulement au principal intéressé, mais aussi à différents protagonistes de sa vie, proches, amis ou professionnels ayant croisé son chemin.
D’entrée, le ton m’a déplu : larmoyant, sentimental, jouant de grosses ficelles émotionnelles comme les films hollywoodiens les plus putassiers (servez-vous, il n’y a que l’embarras du choix), il s’ouvre en effet sur la voix de la mère de James Dean, morte lorsqu’il avait neuf ans. Et ça donne ceci, dès le deuxième paragraphe :
« Les mères devraient s’efforcer de ne pas mourir quand leurs enfants sont si jeunes. Elles devraient attendre un peu. Pour qu’ils ne soient pas tristes, les enfants. »
Pas très subtil, vous en conviendrez.
Et ça ne s’arrange pas par la suite, dans la mesure où Besson n’est pas capable de faire varier le ton de ses différents intervenants. Tous, qu’ils soient fermiers au fin fond de l’Indiana ou célèbres réalisateurs, hommes ou femmes, ils s’expriment tous avec le même niveau de langue, un peu relâché soit dit en passant, assez oral, comme s’ils étaient interviewés à tour de rôle par un narrateur invisible. Ce qui donne au roman une unité de style que son aspect choral n’aurait pas dû lui donner, et casse tout l’intérêt du procédé.
Pour le reste, Vivre vite éclaire sans doute l’enfance douloureuse et la personnalité tourmentée de James Dean, son charisme et son étrange beauté, le rendant attirant autant aux yeux des femmes que des hommes, son ascension fulgurante et sa mort prématurée ; mais le tout manque trop de nuance et d’élégance littéraire pour porter haut une figure aussi singulière, qui aurait mérité mieux que des banalités psychologiques ou des phrases toutes faites.
Vivre vite, de Philippe Besson
Éditions Julliard, 2015
ISBN 978-2-260-02396-8238 p., 18€
Le Bonheur national brut, de François Roux
Signé Bookfalo Kill
Je l’annonçais en présentant sa rentrée il y a quelques semaines : Albin Michel pourrait se targuer d’avoir imposé un genre en soi dans sa production, celui de la grande fresque, du pavé populaire et de qualité, à fort potentiel commercial mais d’une sincérité littéraire irréprochable, choisissant un moment d’Histoire défini pour y camper des personnages inoubliables, avec un souci romanesque propre à enchanter une très grande variété de lecteurs. (Ouf, oui, tout ça !)
Dans ce registre, il y a eu Jean-Michel Guenassia, avec le Club des incorrigibles optimistes et la Vie rêvée d’Ernesto G., Nicolas d’Estienne d’Orves et ses Fidélités successives ; et puis, bien sûr, Au revoir là-haut de Pierre Lemaitre, lauréat l’année dernière d’un prix Goncourt très mérité.
 Cette année, voici donc venir François Roux et son Bonheur national brut. Le cadre historique ? La France des trente dernières années, de l’élection de François Mitterrand en 1981 à celle de François Hollande en 2012. Les personnages ? Quatre garçons, quatre amis âgés de 18 ans lorsque débute le récit, fraîchement titulaires d’un baccalauréat décroché dans la petite ville bretonne où ils ont grandi, et parvenus à l’heure des choix décisifs pour la suite de leur vie.
Cette année, voici donc venir François Roux et son Bonheur national brut. Le cadre historique ? La France des trente dernières années, de l’élection de François Mitterrand en 1981 à celle de François Hollande en 2012. Les personnages ? Quatre garçons, quatre amis âgés de 18 ans lorsque débute le récit, fraîchement titulaires d’un baccalauréat décroché dans la petite ville bretonne où ils ont grandi, et parvenus à l’heure des choix décisifs pour la suite de leur vie.
Il y a Rodolphe, le féru de politique, socialiste de cœur autant que pour faire enrager son père communiste ; Tanguy, promis au commerce ; Benoît, le lent rêveur, qui considère le monde à travers le viseur de son appareil-photo ; et Paul, un peu velléitaire, amoureux de cinéma, embarrassé de son homosexualité que l’époque n’incite guère à exposer, souffrant sous le joug d’un père autoritaire qui ne le voit pas faire autre chose que des études de médecine, en dépit de ses résultats scolaires médiocres, afin de reprendre un jour son cabinet.
Avec un art consommé du roman choral, François Roux expose à tour de rôle les premiers pas dans la vie d’adulte de ses héros, les suivant dans la première moitié du roman jusqu’en 1984, avant de les retrouver à partir de 2009 pour la deuxième partie. Évitant de la sorte de tomber dans le piège trop démonstratif du didactisme, par cette ellipse vertigineuse le romancier confronte directement ses personnages à leurs rêves, à leurs ambitions, à leurs réussites comme à leurs échecs.
Il y a quelque chose de très anglo-saxon dans l’efficacité évidente de cette construction, tout comme dans le style, limpide, et dans l’art d’élaborer les personnages, aussi bien les principaux (dont les femmes gravitant autour des quatre héros, très attachantes et réussies également) que les nombreux secondaires. On pense à Jonathan Coe, par exemple, grand maître britannique de la fresque humaine et critique sur les décennies récentes de son pays. Le sens de la dérision, l’ironie so british en moins chez François Roux, quoique le Bonheur national brut ne manque pas d’humour à l’occasion.
Grâce aux archétypes qu’incarnent ses héros, Roux balaie un grand nombre de sujets de société ayant marqué la France durant ces trente dernières années : dérives de la politique, omniprésence dévorante de la communication, érosion impitoyable du maillage industriel national, cruauté glaciale du management moderne, affirmation de la cause homosexuelle dans la tourmente des années sida… Autant de sujets plutôt sombres, imposés par l’époque, mais que le romancier rend attrayants, justes, passionnants, grâce à l’humanité de ses personnages auxquels ils portent une tendresse palpable, à l’intelligence et à la variété des situations romanesques.
Le résultat, vous l’aurez compris, est imparable. Ce superbe roman d’apprentissage se dévore avec plaisir, on s’y reconnaît souvent, on vibre, on s’émeut, on s’indigne, on se souvient, et on s’étonne d’en avoir déjà achevé les 680 pages. A tel point que, pour une fois, on en redemanderait presque !
Le Bonheur national brut, de François Roux
Éditions Albin Michel, 2014
ISBN 978-2-226-25973-8
679 p., 22,90€
En finir avec Eddy Bellegueule, d’Edouard Louis
Signé Bookfalo Kill
On a coutume de dire que la première phrase d’un roman est la plus importante de toutes. Parce que c’est la clef de l’ensemble, celle qui donne le ton, la couleur, la première impression, celle qui doit embarquer le lecteur et l’empêcher de lâcher prise. Elle a tous les droits, cette première phrase. Elle peut surprendre, faire rire, révulser, intriguer – tout ce qu’elle veut, du moment qu’elle attrape la main du lecteur et la tient fermement.
Dans la plupart des romans contemporains, la première phrase est pourtant rarement aussi marquante. Elle ne ferme pas la porte, mais se contente de l’entrebâiller ; au lecteur de voir si, au fil de toutes les phrases qui suivent, il a vraiment envie de pousser plus loin.
 Parfois cependant, elle est là, elle surgit :
Parfois cependant, elle est là, elle surgit :
« De mon enfance je n’ai aucun souvenir heureux. »
Dans toute sa simplicité apparente – et pourtant, en une tournure élégante, un choix de mots parcimonieux mais d’une justesse totale, elle dit déjà tout. Crochet du droit, lecteur sonné, c’est match gagné.
Voilà. Dès la première phrase de son premier roman, Édouard Louis s’impose en authentique écrivain malgré ses 21 ans, et balance la terrible réalité autobiographique d’En finir avec Eddy Bellegueule à la figure de son lecteur. L’histoire d’un gosse né dans les années 90 en Picardie, famille nombreuse, père au chômage parce qu’il s’est bousillé le dos à force de trimer à l’usine, mère cantonnée à torcher le cul des petits vieux du coin, frère aîné violent, grande sœur déjà soumise aux coups de son mec. Valeurs viriles, trop d’alcool, gloire au foot, petits boulots merdiques, vie plantée à vide dans un village à l’agonie.
Et au milieu de tout ça, Eddy, sa voix trop haut perchée, ses manières efféminées dès gamin, avant même d’être en âge de comprendre qu’il préfère les garçons. Le verdict tombe très vite, sans grâce, primaire : pédé, tantouze. Il faut faire avec, tenter de donner le change, sortir avec des filles, les embrasser alors que ça vous dégoûte. Se laisser martyriser par des petites brutes qui prennent leur pied à cracher sur une victime expiatoire parce que c’est tout ce que leur maigre éducation et leur faible intelligence leur soufflent ; se laisser humilier par son père qui voudrait un fils, un vrai, un dur.
Avant, enfin, de trouver l’occasion de fuir – et, à distance, d’essayer de comprendre.
Il y a tout cela dans En finir avec Eddy Bellegueule, mais sans misérabilisme ni complaisance. Avec, au contraire, encore, de la tendresse parfois pour ceux qu’aujourd’hui Édouard Louis ne voit plus, et qui restent sa famille, ses proches. Le jeune romancier raconte tout, le malaise, le mal-être, la quête de reconnaissance et d’amour, l’incompréhension du corps qui trahit ; il raconte, sans pitié mais avec un sens certain de la justice, autant envers lui-même qu’envers les autres.
Il écrit bien surtout, et c’est là que son récit, que l’on pourrait croire déjà vu, déjà lu, sort de l’ordinaire, se singularise. Parce qu’Édouard Louis y met les formes, le met en forme, jouant habilement avec les niveaux de langue – le sien, celui du narrateur, soigneux, affirmé, contrastant avec les dialogues, la voix des autres, intégrés à la narration, juste mis en évidence par des italiques et par leur pauvreté verbale, leurs scories de tournures, leurs écorchures de grammaire.
Le plus frappant, finalement, c’est de penser, en lecteur éduqué, que tout ceci s’est passé hier, juste à côté, à quelques kilomètres. Une évidence, porte ouverte enfoncée ? Voire. Se souvenir, réaliser que, partout dans notre pays, d’autres gens pensent de la même manière que les proches d’Eddy – le mépris érigé en modèle, la différence moquée, rejetée, écrasée – c’est aussi un peu comprendre la France d’aujourd’hui, ses difficultés, ses aigreurs, sa violence.
Une réalité qui échappe sans doute à trop de ceux pour qui la vie est facile, et qui n’ont jamais l’élégance de s’en rendre compte et de s’en féliciter. Pour s’en convaincre, une anecdote, rapportée par Édouard Louis dans la Grande Librairie : certains éditeurs parisiens, à qui il avait adressé son manuscrit, ont refusé de le publier parce qu’ils le jugeaient caricatural, irréaliste. Tout est dit ?
Non. Une dernière chose : lisez En finir avec Eddy Bellegueule, ça pourrait vous faire du bien là où ça vous fera du mal.
En finir avec Eddy Bellegueule, d’Édouard Louis
Éditions du Seuil, 2014
ISBN 978-2-02-111770-7
220 p., 17€
